« PRESOMPTIONS ET RESPONSABILITES – APPROCHE DE DROIT COMPARE (FRANCE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ITALIE, POLOGNE, CANADA) », sous la dir. de Anthony Tardif, Mare&Martin, mai 2024
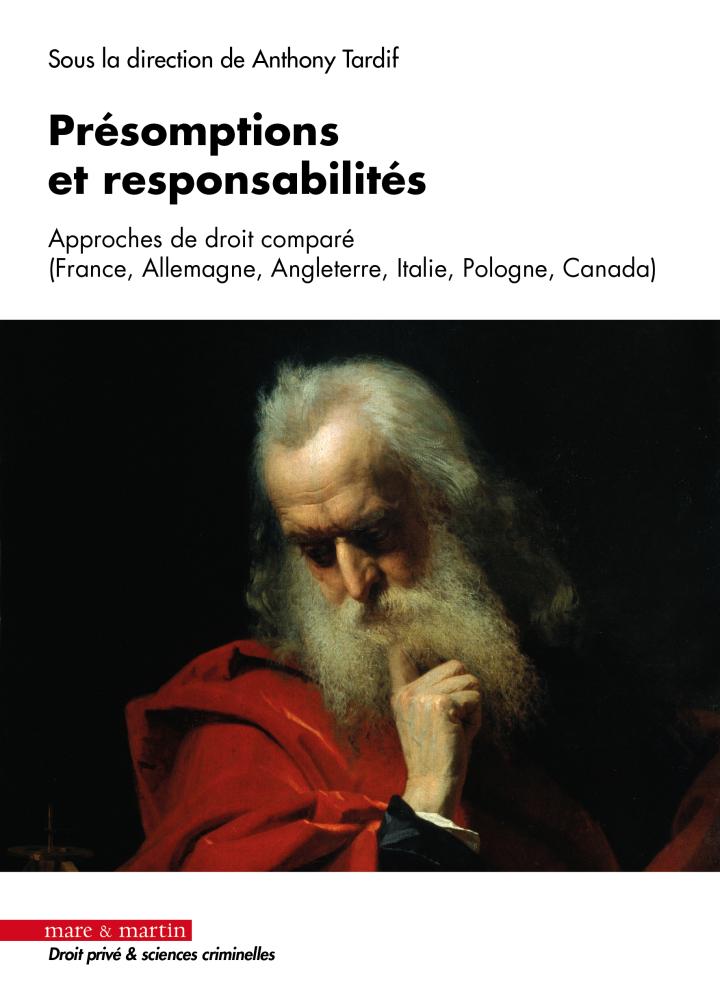
La notion de présomption est d’usage courant en science juridique, certains auteurs assimilant parfois les modes de réalisation des droits au droit lui-même. Pourtant, les études systémiques sur les présomptions ne sont pas monnaie courante en droit de la responsabilité. Il faut dire que le sujet dérange. Profondément attachée au triptyque des conditions classiques de la responsabilité indemnitaire (faute, dommage et lien de causalité), la présomption aboutit tantôt à supprimer une de ces conditions tantôt à les confondre toutes. Ainsi, la fameuse « faute incluse dans le dommage » ou « res ipsa locitur » aboutit à démontrer une faute en prouvant le dommage. De plus, les présomptions de causalité en matière de pannes mécaniques ou de dommages transfusionnels nécessitaient une relecture de ce phénomène. L’ouvrage « Présomptions et responsabilités », qui fait suite au colloque international qui a lieu à l’Université de Haute-Alsace le 22 septembre 2023, permet de voir qu’il ne s’agit pas d’un phénomène propre au système juridique français. Le lecteur prendra ainsi connaissance du fait que les présomptions de faute, considérées comme en voie de raréfaction en droit français, connaissent un regain d’intérêt en droit québécois (notamment en matière de responsabilité parentale). De même, le phénomène des présomptions de dommage, dont on trouve des illustrations notamment en droit du travail et en droit administratif, a des homologues en droit italien et en droit anglais. Enfin, la proposition émise par le Parlement européen le 20 octobre 2022 aboutit à instaurer un système de présomption de faute pour les dommages causés par les systèmes d’intelligence artificielle (IA) ne présentant pas un haut risque. Par où l’on voit que l’ancienne figure de la « présomption » connaît une véritable actualité.