Jérémy FORNY,
Etudiant en Master 1 droit social à la Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques de Mulhouse, Université de Haute-Alsace
Crise sanitaire oblige, c’est sur Zoom que le Professeur Blandine ROLLAND a souhaité la bienvenue aux conférenciers, réunis le mardi 9 février 2021 à 13 heures, à l’occasion de la première table ronde venant rythmer les 25 ans du Centre européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes, CERDACC (lire le programme ici ). Cette table ronde était organisée sous la houlette de Valentine ERNÉ-HEINTZ, Maître de conférences HDR en aménagement de l’espace, urbanisme et Chrystelle LECOEUR, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, toutes deux enseignantes à l’Université de Haute-Alsace et membres du CERDACC.

Après une présentation de la table ronde et des enjeux suscités par un rapprochement de la santé publique et de la santé au travail au regard notamment de l’actualité par Chrystelle LECOEUR, Valentine ERNÉ-HEINTZ n’a pas manqué de remercier les différents intervenants. Cette table ronde qui avait pour vocation d’aborder les problématiques de santé sous le prisme du Risque se déroula en deux parties, une première était consacrée à la santé publique (I), puis la seconde à la santé au travail (II).

I/ Table ronde consacrée à la santé publique
Cette table ronde animée par Valentine ERNÉ-HEINTZ et Paul VÉRON, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Nantes a fait place à trois interventions axées sur la santé publique, elles furent l’occasion de revenir sur les problématiques vaccinales selon le point de vue des libertés, de la protection des majeurs vulnérables et du droit pénal.
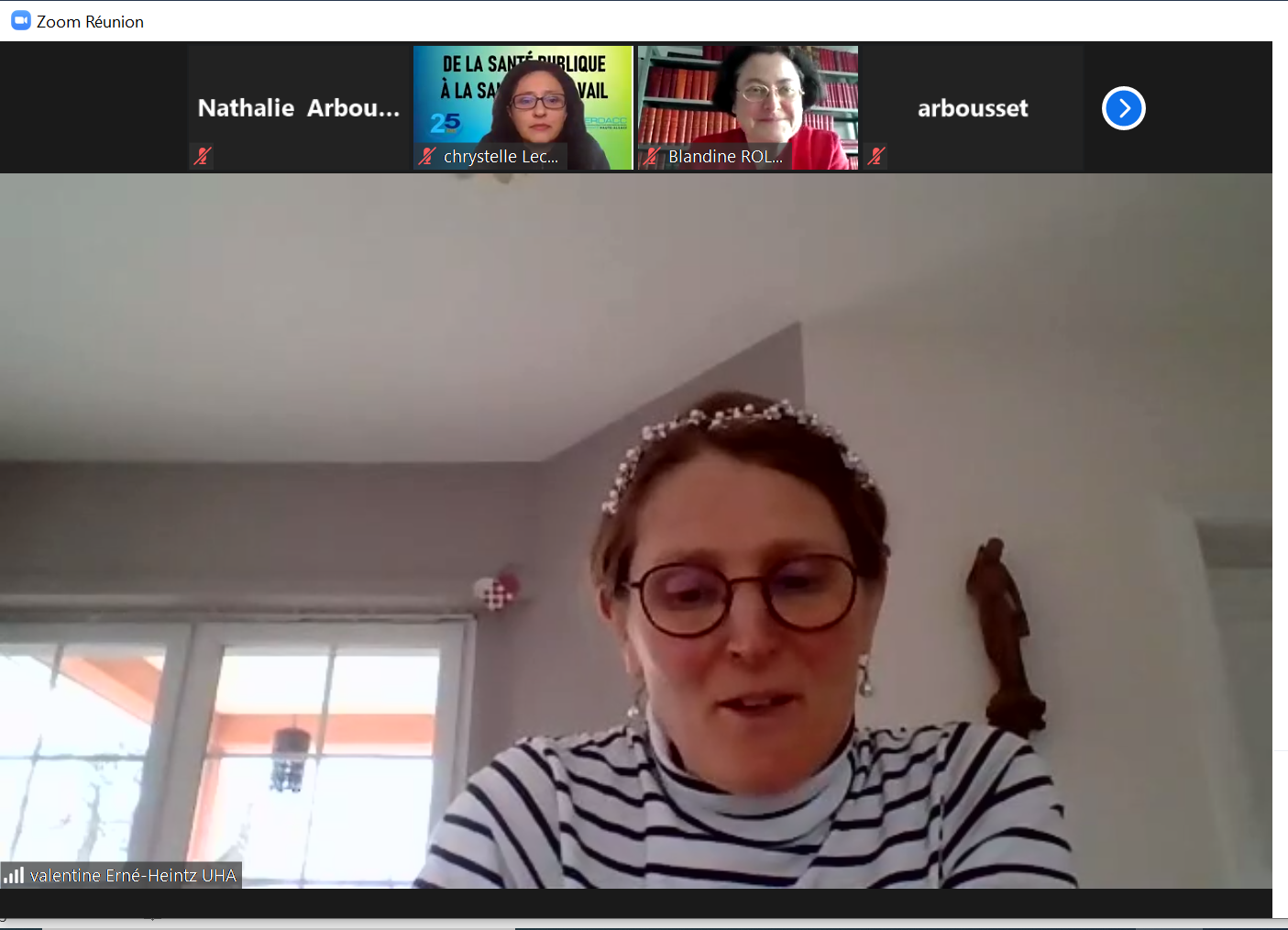
« Vaccination et libertés individuelles », Me Amélie ROBINE, avocate associée au sein du cabinet Beaubourg Avocats (Paris) :
Les vaccins constituent des traitements immunologiques contenant du matériel viral, bactériologique ou parasitaire, et à ce titre ils ne sont pas dénués de risques pour l’Homme. À cet égard le médecin et son patient bénéficient de droits et d’obligations qu’il convient d’analyser pour définir le risque juridique encouru. Concernant la responsabilité du praticien, l’on rappellera qu’il est soumis à un Code de déontologie, notamment aux articles 32 à 55, et certaines normes sont inscrites au Code de la santé publique.
- Principe de qualité des soins : il est défini par des prestations consciencieuses et dévouées. Il s’agit ni plus ni moins que du contrat de soin, consacré par l’Arrêt Mercier (Civ., 20 mai 1936, DP 1936, 1, p. 88).
- Principe d’information du patient : l’information doit être fournie de façon claire, loyale, appropriée et doit déboucher à un consentement libre et éclairé. Cela génère un risque qui laisse encourir la responsabilité du professionnel, et à ce titre il doit apporter la preuve sur l’information fournie et son contenu. Ce préjudice lié au défaut d’information du patient peut être distinct du préjudice corporel.
- Principe de consentement éclairé : son corolaire est présent à l’article 16-3 du Code civil. Il est sanctionné autant sur le plan civil que sur le plan professionnel.
- Principe de protection contre un risque injustifié : le praticien ne doit d’aucune manière faire courir un risque disproportionné à son patient. Son évaluation reposera sur une analyse de la balance bénéfice/risque, et reposera sur les données connues du praticien sur le traitement et celles communiquées par le patient sur son propre état.
Concernant le patient, il existe également certains droits dont il bénéficie :
- Principe de dignité : étant contenu dans le préambule de la Constitution d’octobre 1946, il a valeur constitutionnelle. Il s’inscrit comme l’opposition à un être humain objet ou moyen. Ce principe est néanmoins écarté par le Conseil d’État, qui estime que la vaccination a pour but de garantir un autre principe constitutionnel de santé publique (CE, 26 novembre 2001, 222741).
- Principe du droit à la vie : il est consacré à l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et se définit comme la protection de la vie humaine. Néanmoins, en matière vaccinale, il est écarté lorsqu’un objectif de la protection de la communauté vient écarter la mort intentionnelle (CEDH, X c/ Royaume-Uni, 12 juillet 1978), ou encore lorsqu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre la vaccination et la mort (CEDH, Boffa et autres c/ Saint-Marin, 20 août 1998).
- Principe de droit à la vie privée : il est consacré à l’article 8 de la Convention et trouve une application pratique en l’espèce puisqu’il sanctionne l’atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé.
- Principe d’information du patient : il est inscrit à l’article L1111-2 du Code de la santé publique, et dispose que sauf urgence, le patient doit avoir eu une information préalable sur son état de santé, le contenu de l’acte envisagé, l’opportunité, les alternatives thérapeutiques ainsi que leurs avantages et inconvénients, et les conséquences d’un refus du patient. Une information ultérieure supplémentaire est imposée lorsque des risques sont nouvellement identifiés.
Ainsi donc, un certain nombre de questions restent en suspend au regard du fait que le gouvernement semble endosser le risque vaccinal en lieu et place des laboratoires, cela sans recul. La responsabilité de l’État sera-t-elle engagée pour ces injections ? Prendra-t-elle la forme d’un fonds d’indemnisation des éventuelles victimes ?

« La vaccination des personnes vulnérables : enjeux juridiques et éthiques », Paul VÉRON, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Nantes, membre associé du CERDACC :
En France, la vaccination est qualifiée juridiquement d’acte médical préventif et invasif. Aussi, l’article 1111-4 alinéa 4 du Code de la santé publique prescrit-il le consentement pour ce type d’actes. En effet, l’obligation vaccinale reste une exception, l’article L3111-1 du Code de la santé publique rendant obligatoires onze vaccins pour les mineurs, et certains autres pour l’accès à certaines professions (notamment de santé) ou certains territoires (le vaccin pour la fièvre jaune en Guyane notamment). Toutefois, cela ne constitue nullement vaccination forcée. Ainsi, l‘on ne peut en principe procéder à une injection sans consentement, et les conséquences se limiteront donc à la mise en péril de mineur (art. 227-17 du Code pénal), ainsi qu’à l’interdiction d’accès à certains lieux publics, qui n’est en soit pas une sanction, mais une conséquence selon la Jurisprudence.
En soi, l’obligation vaccinale est encadrée, et doit résulter d’une loi contenant également les considérations de santé publique et une proportionnalité atteinte par la balance contrainte et risque par rapport au bénéfice (CE, 6 mai 2019, n° 419242). Le gouvernement dans son projet de loi n° 3714 du 21 décembre 2020 propose notamment de modifier le Code de la santé publique, ce qui laisse entrevoir que cette vaccination pourrait devenir obligatoire sous forme d’un possible « passeport vaccinal ».
Pourtant, comme le souligne le Comité consultatif d’éthique dans un rapport intitulé « Enjeux d’une politique vaccinale Sars-CoV-2 », le public le plus spécifiquement visé est les personnes âgées et diminuées, qui résident souvent en EHPAD. Cela n’est pas sans poser des difficultés au regard du consentement de ces personnes :
- Certaines ont un état mental ou cognitif dégradé qui rend le consentement impossible.
- Certains ont un discernement incertain.
- Certains ont des attitudes de rejet ou d’opposition liés à des troubles cognitifs.
- Certains ont des pathologies neurodégénératives.
- Certains, enfin, ont la crainte de pressions du fait de leur vulnérabilité.
Ainsi, il existe différentes méthodes développées pour ces publics pour s’assurer du consentement. L’on songera notamment au « MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment » ou au « Mini mental state » qui s’adresse plus spécifiquement aux pathologies neurodégénératives. La Haute-Autorité de santé, quant à elle, s’inspire de ces modèles et préconise cinq phases : capacité à recevoir l’information, comprendre et écouter, raisonner, expression libre de la décision, et enfin réitération dans le temps.
Qui plus est, dans certains cas, il est possible d’obtenir le consentement même lorsque la personne ne semble pas en capacité. Ainsi, un rapport « Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ? » dirigé par Fabrice Gzil, responsable du Pôle réseaux et observatoire, espace de réflexion éthique d’Île-de-France, indique que cela est parfaitement envisageable, comme la Jurisprudence l’a déjà montré par le passé, en adoptant une certaine souplesse devant la démence sénile d’un résident d’EHPAD en lui reconnaissant la capacité de consentir à une relation sexuelle (CA Paris, 9 mars 2016).
L’article L1111-4 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que le consentement d’un résident capable de s’exprimer doit-être respecté et ce même s’il est exprimé par des gestes, expressions faciales… Est ainsi prohibé le forçage alimentaire (CA Metz, 7 janvier 2013, n°10/0419) ou le shampoing administré de force (CA Dijon, 19 novembre 2015, n°14/00517). Il existe toutefois deux exceptions particulières, faisant écho à l’obligation de porter secours, et qui permettent de contourner ce consentement :
- R4127-9 du Code de la santé publique et Art. 223-6 du Code pénal : en cas d’urgence médicale caractérisée par un danger grave et imminent pour la personne
- En cas de nécessité thérapeutique évidente. Cette nécessité est évaluée sur deux critères. Toute d’abord, il faut un risque élevé de contamination pour le malade et des conséquences graves au regard de la non-vaccination d’une part et des complications éventuelles d’autre part. Enfin, le bénéfice doit être nettement supérieur au risque, qui est analysé selon le degré d’efficacité sur la personne, l’efficacité au regard de la transmission du virus, et les effets indésirables.
Enfin, lorsqu’il n’est pas possible de recueillir le consentement, plusieurs cas sont prévus :
- Pour les personnes sans mesure de protection, l’on devra recueillir simplement l’avis de la personne de confiance ou des proches.
- Si une mesure de protection existe, y compris sur la personne et pas uniquement sur le patrimoine, l’article L1111-4 alinéa 8 du Code de la santé publique prévoit que dans un premier temps la personne décide pour elle-même, assistée si besoin. Si cela n’est pas possible, le représentant donne son accord. Si ce dernier exprime son refus, ne s’agissant pas d’un traitement, il faudra alors saisir le juge pour pouvoir transiger.

« Le vaccin à l’épreuve de la précaution en droit pénal », Chloé LIÉVAUX, Maître de conférences contractuel à l’Université de Lorraine, membre associé du CERDACC :
Le droit pénal de la santé distingue la pandémie du virus, la séparation de ces notions impliquant d’une part la santé publique et d’autre part les conséquences individuelles. Pourtant, la logique préventive de la vaccination semble éloignée du droit pénal.
En l’espèce, l’essentiel de l’action a consisté à déterminer un ordre public sanitaire, protégé par le droit pénal, au moyen de règles parfois inadaptées. Pour le confinement, l’on songera notamment à l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, qui a donné lieu à des gardes à vue qui ont été censurées au motif que l’infraction n’était pas qualifiée et donc que l’on ne pouvait se situer en matière délictuelle ou criminelle. L’action du législateur a par ailleurs permis de créer des contraventions et de correctionnaliser certaines récidives.
Mais face à la nécessité de protéger l’ordre public sanitaire, deux difficultés se présentent en matière pénale : L’accélération de la mise sur le marché a conduit à rendre la frontière entre innovation, recherche et soins floue, et cela est problématique au regard du principe de légalité en matière pénale qui impose une transparence absolue. Qui plus est, ce même ordre public sanitaire se trouve en recule. Effectivement, il semble désormais que l’on se dirige de plus vers une individualisation de la santé à mesure que les vaccinations obligatoires baissent avec la diffusion des maladies. Malgré tout, cet ordre public sanitaire subsiste, et les usagers se doivent de respecter comme l’indique l’article L1111-1 du Code de la santé publique. Il en va effectivement des principes de distributivité (égalité d’accès), efficacité et d’innocuité de la vaccination.
S’agissant du principe d’égalité d’accès tout d’abord, il peut sembler compromis lorsque l’on songe au monopole des brevets des laboratoires, d’autant que ces brevets courent pendant une période de 20 ans. C’est pourquoi il existe deux exceptions que sont les licences d’office et les licences obligatoires. S’agissant de produits intéressant la santé publique, un règlement européen de 2006 vient permettre ces mécanismes avec des règles uniques. En France, tout brevet médical est soumis à ce régime, et le Code de la santé publique s’attache à rendre possibles par tous moyens la distribution et la fabrication de remèdes pouvant éradiquer une épidémie. Ces mécanismes trouvent une certaine utilité lorsqu’un laboratoire vend son vaccin à un prix déraisonnable ou que sa distribution est empêchée ou retardée, et permettent ainsi de contourner les dispositions pénales du Code de la propriété intellectuelle.
Sur la qualité et l’innocuité des vaccins, là encore le droit de la propriété intellectuelle intervient, notamment par la convention MEDICRIME. Cette dernière s’attache à éradiquer la contrefaçon de produits médicaux, qu’ils soient sous fausse source, fausse identité, ainsi que dérivés des chaines légales d’approvisionnement. En France, le Code de la santé publique prévoit ainsi une peine de 5 ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende pour tout produit pharmaceutique dont la présentation ou l’identité sont trompeuses ou falsifiées. Cette infraction s’applique à l’ensemble de la chaîne : publicité, export, courtage, distribution, peu importe que le produit soit ou non fidèle à celui qui est falsifié.
Sous l’angle des droits individuels du patient, les deux principes les plus importants seront ici le consentement éclairé du patient et la responsabilisation des acteurs de santé. En effet, la vaccination obligatoire ne rencontre plus de sanction pénale à ce jour. En fait, devant l’inefficacité de la sanction pénale, il est apparu plus opportun de parier sur la responsabilisation et la confiance que sur la sanction. Néanmoins, l’on rappellera ici que l’article 227-27 du Code pénal vient toujours sanctionner les parents qui voudraient soustraire leur enfant à la vaccination obligatoire lorsque cela aurait pour conséquence de compromettre sa santé.
Pour garantir la confiance du public, les vaccins obligatoires font l’objet d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM. Les vaccins du Covid-19 ne sont pas dans cette catégorie, d’autant qu’ils n’ont pas été éprouvés par les mêmes mécanismes que les autres vaccins, mais le ministre de la Santé a confirmé qu’il serait adossé à ce même régime prochainement.
S’agissant de la typologie des infractions, l’on pourrait difficilement retenir deux infractions intentionnelles que sont l’empoisonnement ou l’administration de substances nuisibles. Dans le premier cas, il faudra démontrer que la substance pouvait donner la mort, mais surtout qu’il y avait une intention de donner la mort (cf. Affaire du sang contaminé, Crim. 188 juin 2003, n°02-85.199). Dans le second cas, l’échec porterait fatalement sur la démonstration d’un lien de causalité entre la substance administrée et l’atteinte physique qui en résulterait, ainsi que l’iter criminis.
S’agissant des infractions non intentionnelles, l’on ne sera pas d’avantage avancé tant elles semblent inadaptées. Il est toutefois à noter qu’un mécanisme de protection a été décidé par la Commission européenne et les États membres définissant que l’État devra prendre en charge les éventuelles indemnisations au moyen d’un financement trouvé par des contrats confidentiels avec les laboratoires. Mais cela n’effacera pas la responsabilité civile des laboratoires, à moins qu’ils prouvent ne pas avoir pu être informés de ces effets, ce qui sera facile en l’état. Au civil, une présomption grave, précise et concordante permettrait de reconnaitre un lien de causalité si l’incertitude scientifique demeure, ce qui n’est pas le cas au pénal (cf. Affaire Tchernobyl, Crim. 20 nov. 2011, n° 11-87.531). Et si la causalité indirecte était démontrée, il conviendrait alors de prouver une faute qualifiée (violation délibérée d’une obligation de santé ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement) ou caractérisée (exposition consciente à un risque que l’on ne pouvait ignorer). Là encore, l’absence de données laisse planer un risque sur la possibilité ou non de reconnaitre cette infraction. Ainsi, il conviendrait de s’interroger sur l’opportunité d’adapter le droit pénal à ce contentieux sanitaire sériel à l’avenir.

II/ Table ronde consacrée à la santé au travail
Cette table ronde animée par Chrystelle Lecoeur et Benjamin Wiart, Avocat au barreau de Lyon, a permis à quatre spécialistes de traiter des problématiques de santé au travail, et plus particulièrement de la maladie professionnelle au prisme des pesticides, de l’expertise, au regard des nouveaux risques et de l’amiante dans une approche comparative avec le droit italien.
« Genèse de l’émergence d’une maladie professionnelle : l’exemple des pesticides », Giovanni PRETE, Maître de conférences en sociologie à l’Université Sorbonne Paris Nord, IRIS :
L’exemple des pesticides est peut-être le sujet le plus parlant quand il s’agit d’évoquer la santé ou l’environnement tant ce domaine est clivant. Néanmoins, force est de constater que le sujet est moins évoqué lorsqu’il s’agit de la santé au travail, et qu’il ne génère pas les mêmes mobilisations. Plusieurs enquêtes collectives ont pourtant eu lieu qui ont permis de mettre en exergue certains facteurs sociaux qui font des pesticides un sujet de société essentiel, notamment depuis que les mouvements sociaux se sont saisis des intérêts des travailleurs agricoles. Si ces mouvements ont contribué à l’émergence de dispositifs institutionnels sur la question, ce mouvement n’est pas sans limites.
Entre les années 1950-2000, ce sujet à pu sembler ignoré. En effet, les trente glorieuses ont eu un impact significatif sur les technologies, et l’agriculture à pu bénéficier de cette promesse de rendements améliorés en utilisant notamment les pesticides. La gestion du risque et son encadrement étaient alors limités essentiellement à la prévention des intoxications aiguës. Il faudra attendre pour voir les premières contestations, certes résiduelles, au nom de l’impact environnemental de ces technologies.
C’est réellement dans les années 2000 que la prise de conscience a émergé s’agissant des maladies professionnelles. C’est en effet le début d’une médiatisation importante du risque, qui donne lieu à une multiplication des rapports et à des mobilisations de victimes qui portent leurs cas devant les juridictions.
Ce sont donc bien les victimes qui sont à l’origine de la politisation de ce débat. Le plus étonnant est peut-être même que ce sont les exploitants agricoles eux-mêmes qui se mobilisent dans ce débat en faveur des phytovictimes. Et la première limite est bien là : l’exploitant n’est-il finalement pas en position de supériorité par rapport au risque ? Et quid des autres victimes ? Cette mobilisation a pourtant permis de dépasser les clivages traditionnels : travailleurs contre patrons, victimes contre agriculteurs.
Ce mouvement de politisation a d’autant pu avoir lieu que le contexte l’a permis : évolution des données épidémiologiques et surtout évolution du cadre juridique (Cf la loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 sur l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés du domaine agricole). Qui plus est, le profil démographique de l’exploitation agricole a aussi changé au fil des ans, et désormais les structures traditionnelles de représentation semblent usitées, et le droit accompagne ce mouvement, alors qu’une professionnalisation de l’activisme en santé environnementale se dessine.
Le résultat de cette mobilisation est significatif. En effet, elle a permis l’établissement d’un tableau des maladies professionnelles, un fonds d’indemnisation des victimes est en cours de déploiement et une pression s’exerce à toutes les échelles sur les agences sanitaires pour revoir plus drastiquement les procédures de contrôle des substances.
Néanmoins, cette politisation peut sembler précaire à ce jour. En effet, qui aujourd’hui pourrait se mobiliser et pour quelle cause ? En effet, un cadre institutionnel existe désormais pour diffuser des ressources et le cadrage de la reconnaissance en maladie professionnelle fait que cet enjeu est désormais plus une question de prévention ou de réparation que de politique.
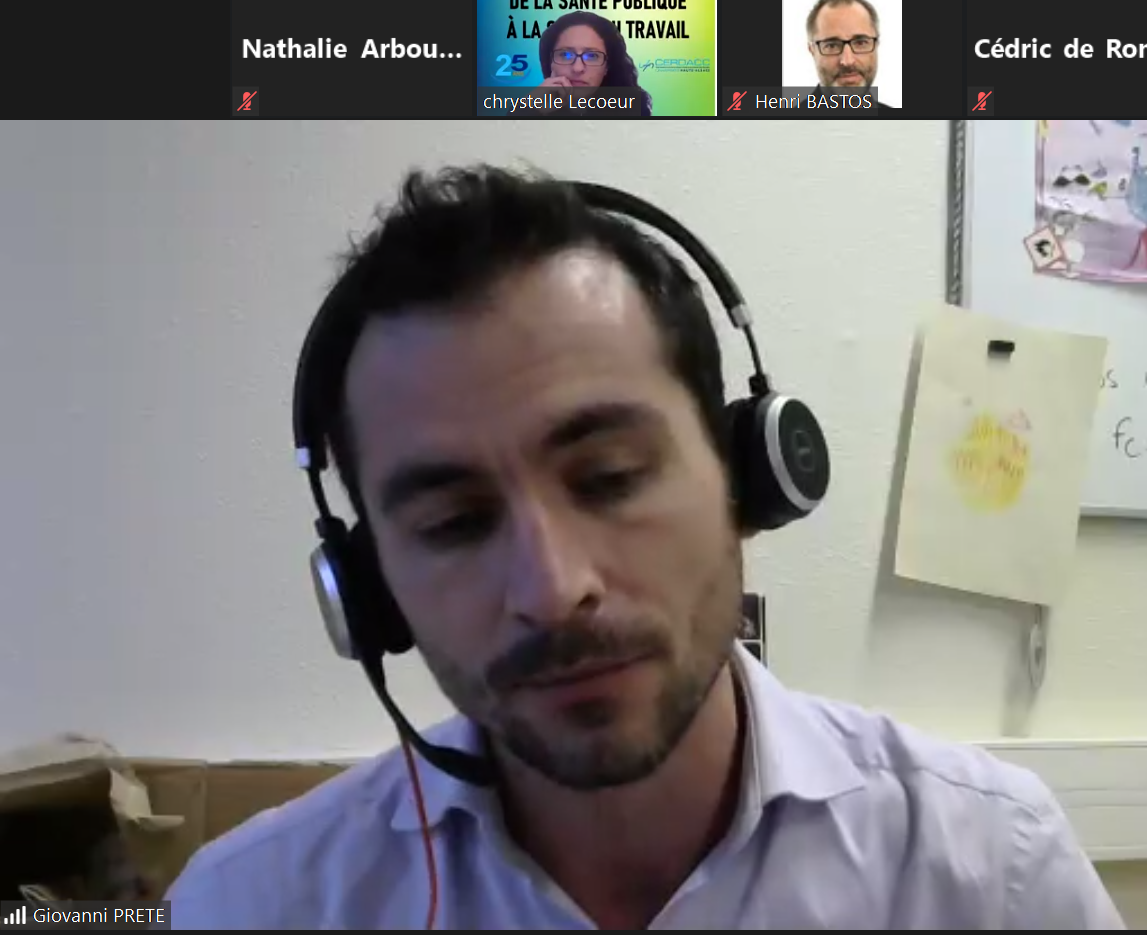
« L’expertise face à la codification d’une maladie professionnelle », Henri BASTOS, Adjoint au directeur de l’évaluation des risques en charge de la Santé-Travail, direction de l’évaluation des risques à l’ANSES :
Le travail de l’expert s’agissant de la maladie professionnelle est encadré, et cette codification prend plus particulièrement la forme d’un tableau de classification. Ces tableaux sont établis ou modifiés sur la base des connaissances scientifiques, et permettent d’établir un lien causal entre l’exposition ou les conditions de travail avec une maladie. Ils comportent trois colonnes dont une concernant la maladie dont les critères sont cumulatifs et obligatoires, une concernant le délai maximum pour la prise en charge entre la dernière exposition et la première constatation des symptômes, et une liste limitative ou indicative des travaux concernés.
Il existe néanmoins plusieurs facteurs qui font que la reconnaissance la maladie professionnelle pose parfois des problèmes :
- Problèmes inhérents au salarié : sous-déclaration de la victime ou de ses ayants droit, défaut d’information de la victime, problème moral à mettre en difficulté un employeur, difficultés économiques, pression de la hiérarchie, ou impossibilité de réunir des preuves d’exposition dans un contexte de traçabilité défaillante et de précarisation du marché de l’emploi.
- Modalités de traitement des dossiers, qui génèrent des rejets pour des raisons administratives le plus souvent.
- Autres facteurs qui a trait au contenu même des tableaux de reconnaissance.
En effet, l’imposition de la science dans ce processus n’est ni simple ni directe. Depuis la loi du 25 octobre 1919, les partenaires sociaux sont les principaux acteurs de ces négociations, et les discutions scientifiques n’étaient finalement qu’un élément au côté des finances ou de la politique au sein d’une confrontation entre syndicats. À tel enseigne qu’il n’existe à ce jour que 120 tableaux, dont trois créations et cinq modifications en 21 ans.
Aujourd’hui, il apparait donc évident que ces classifications présentent un décalage entre les facteurs de risque identifiés et leur prise en compte, surtout lorsque l’on sait qu’à ce jour une centaine de substances sont considérées de façon certaine comme cancérogène sans apparaitre aux tableaux. Cela abouti à un déséquilibre structurel avec la prise en charge matérialisée par un écart entre les estimations d’exposition et les déclarations réelles, et c’est pourquoi le gouvernement, en 2018, a pris l’initiative d’ouvrir la voie à une expertise scientifique indépendante de la phase de négociation confiée à l’ANSS. Elle a composé en 2019 un groupe de travail pluridisciplinaire incluant la médecine du travail, la toxicologie, l’épidémiologie, l’hygiène du travail, l’ergonomie, la sociologie ou le droit social. Elle a permis la mise en place d’une méthodologie précise, qui devrait trouver une application pratique dans la reconnaissance du lien causal entre cancer de la prostate et pesticides.
Mais cela ne pourra certainement pas seul réussir, tout d’abord car le cadre de la recherche qui coordonne ce travail se trouve limité également par ses choix méthodologiques ou structurels qui reposent sur un ensemble de postulats et de choix. Qui plus est, la médecine aujourd’hui manque peut-être d’éléments pour apprécier l’opportunité ou non de faire évoluer la règlementation, mais à tout du moins elle pourra nourrir la réflexion des instances sur ces questions.
Enfin, le fonctionnement de ce système, pensé il y a cent ans était alors adapté à des risques comme le saturnisme, ayant une causalité directe avec la maladie. Or aujourd’hui, le risque semble désormais multifactoriel et repose sur un long délai de latence (l’on aura des maladies liées à la fois à la génétique, à l’environnement, aux conditions de travail…). À ce titre, les représentants patronaux, dont les membres ne veulent pas voir leurs cotisations augmenter avec la sinistralité de leur entreprise, ont tout intérêt à freiner la création ou la modification des tableaux. C’est pourquoi certains auteurs proposent d’abroger la présomption d’origine. D’autres proposent des diagnostics différentiels d’exclusion visant à écarter d’autres causes au surplus de la procédure, principe rejeté par le Conseil d’État, car contraire à cette présomption. D’où l’idée d’aménager cette présomption d’imputabilité. Enfin, un nouveau rapport sénatorial de 2019 propose d’instituer un prorata à chaque risque afin de tenir compte de la responsabilité de l’employeur dans le cadre d’une affection multifactorielle dont certaines sont externes au travail. Ainsi, il est probable que ce régime soit amené à être complété ces prochaines années.

« La frontière poreuse entre maladie professionnelle et accident du travail : illustrations à travers les « risques nouveaux » », Cédric de ROMANET, Avocat associé au sein du cabinet TTLA (Paris) :
Les notions d’accident et de la maladie professionnelle sont toutes deux érigées par le droit par une loi du 12 juin 1893 et un décret du 10 juillet 1913. Avant cette dichotomie, l’on avait une seule notion qui visait à assurer la santé au travail, et elle était évoquée sous la condition d’une nécessaire hygiène ou salubrité pour la sécurité du travailleur.
Le critère traditionnel qui sépare accident du travail et maladie professionnelle est généralement matérialisé par la soudaineté des évènements, et de ce fait il peut être identifié facilement lors d’un dommage corporel. Toutefois, avec l’émergence de risques nouveaux, cette frontière a tendance à devenir floue. Ainsi, il existe une possibilité de qualification double s’agissant par exemple de la Covid-19, qui semble également relancer ce débat tant il peut être délicat de déterminer le lieu de la contamination, seule la date précise pourra permettre « d’opter » pour l’un ou l’autre des choix, bien que seule la forme grave (nécessitant une assistance respiratoire) puisse être considérée, restreignant la présomption d’imputabilité et obligeant ainsi le salarié à prouver le lien de causalité.
Par ailleurs, le « burn out » ou le risque psychique est difficile à cadrer également. Il est ajouté par l’article 27 de la loi du 17 août 2015, mais doit être déterminé en dehors de toute présomption. Là encore, où est la frontière, lorsque l’on songe au par exemple au suicide ? Chaque procédure aurait son avantage. Par exemple, si le geste a lieu au temps et lieu du travail, la reconnaissance de l’accident du travail semble acquise. Mais s’agissant d’un accident, il sera ensuite compliqué de voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur par la suite. À l’inverse, si l’on choisit la maladie professionnelle, alors la reconnaissance sera plus compliquée en l’absence de présomption. Mais en revanche la faute inexcusable de l’employeur peut s’apprécier sur une période plus large.
Enfin, la reconnaissance du préjudice d’anxiété au travail depuis les arrêts d’avril 2010 par la Cour de cassation pose également la question à cet égard. Depuis le 5 avril 2019, la Cour étend aux salariés qui n’ont pas pu bénéficier de la préretraite amiante, une reconnaissance d’un préjudice d’anxiété (Ass. 5 avril 2019, n° 18-17.442). Il en est de même pour les salariés exposés à des produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, ce qui par la même étend le domaine de ce préjudice d’anxiété (Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879 à 17-25.623). Cette atteinte infra pathologique peut-être directement liée à une maladie professionnelle, et donc l’atteinte psychique résulte bien du travail.
En fait, il semblerait qu’il faille séparer en deux catégories ces problématiques. D’abord, la contamination pourrait s’observer de façon objectivable. C’est-à-dire que des traces peuvent s’observer dans l’organisme, et qu’un début de pathologie peut porter la prescription à dix ans. Il y aurait ensuite une catégorie non objectivable, qui s’observerait sur la durée et ne pourrait être diagnostiquée que par un examen invasif, comme l’amiante. Cette problématique pourrait aussi, à terme, être transposée au plancher de 25% d’incapacité permanente ou temporaire, si l’on considère qu’il y a une parenté avec l’atteinte physique ou psychique, mais sans conséquence directe.

« La responsabilité pénale dans les cas d’expositions aux substances nocives, le cas de l’amiante (approche comparative : Italie) », Valentina FELISATTI, doctorante à l’Université de Ferrara en Italie :
La société a de plus en plus besoin de pouvoir identifier les responsables d’une catastrophe sanitaire. Ce besoin se matérialise, notamment en Italie, par un recours à l’outil pénal dans les affaires d’exposition ou de rejets de substances toxiques. À cet égard, l’exemple de l’amiante est marquant, et force est de constater que l’usage de cet outil se trouve fréquent. Ainsi, l’on peut catégoriser la gestion pénale de ce risque sous deux catégories d’infractions : les délits d’homicide et de blessures involontaires, d’une part et les délits contre la santé publique, d’autre part.
Les délits de résultat visent ici ceux contre la vie et l’intégrité physique individuelle. La difficulté dans cette catégorie sera de trouver un lien de causalité certain entre l’exposition à l’amiante et la maladie. Cela est compliqué en raison du caractère multifactoriel de la maladie et les pathologies ne présentent pas de trait distinctif permettant de relier la maladie avec l’exposition. Qui plus est, il peut y avoir une pluralité diachronique de chefs d’entreprises pour un même salarié, et ce dernier peut aussi rencontrer une pluralité de facteurs alternatifs (si le malade était fumeur par exemple). C’est pourquoi dans plusieurs affaires, il a été considéré que l’on ne pouvait prouver le lien de causalité. Mais dans la majorité des cas, le juge à été conduit à retenir des causes contributives concomitantes, une synergie entre tous cas facteurs alternatifs et l’amiante, pour retenir le lien de causalité. La longue latence conventionnelle des maladies, soit les cycles entre l’exposition et la manifestation clinique de la pathologie, pose aussi un problème dans la mesure où seule la date de début et de fin de l’exposition sont connues et les quantités et périodes précises demeurent incertaines. De plus, l’incertitude scientifique quant notamment à la quantité exposée, laisse aussi planer un doute : si la dose est importante dans la durée.
L’arrêt Courtzini de 2010 fixe à cet égard plusieurs critères qui doivent guider le juge dans le choix de l’étude qui lui servira de base juridique : indépendance de l’étude réalisée, consensus de la communauté scientifique … et doit justifier spécifiquement son raisonnement et indiquer les données précises de l’étude utilisée.
Qui plus est, lorsque la pathologie dépend de la dose, il faudra rechercher le « Failure time » pour définir le lien de causalité, soit le moment à partir duquel l’exposition n’a plus produit d’autres effets. Là encore, la Cour de cassation italienne, après avoir rejeté certains liens de causalité, a défini qu’il était correct de revenir à une argumentation causale en prenant comme base la date du diagnostic, en y soustrayant la durée moyenne de la latence de sorte que la date obtenue soit celle retenue pour déterminer ce « Failure time » dont l’on retiendra également l’exposition ultérieure.
Mais pour déterminer l’infraction, il faudra en plus du lien de causalité prouver la faute d’imprudence, mais contrairement au système français il n’y a pas de distinction entre auteur direct ou indirect, et donc il n’y a pas de distinction entre la faute qualifiée, caractérisée ou simple. En revanche, le résultat devra être prévisible sur la base des connaissances scientifiques et du comportement de l’employeur. Tout le problème résultera alors de l’absence de connaissances scientifiques certaines, qui font que le système repose davantage sur la précaution que sur la prévention.
Enfin, devant l’affluence de victimes, et pour éviter la déformation des critères d’imputation du droit pénal, il a aussi été nécessaire dans le cadre des procès avec une importante pluralité de victimes, comme pour les procès Eternit, de trouver une solution pérenne. Ainsi, l’on a pu voir reconnaitre l’infraction de mise en danger collective, qui est un type d’infraction utilisé pour la survenance de catastrophes. Ces infractions sont caractérisées par un évènement à partir duquel un danger pour la sécurité publique se propage. Il n’est pas nécessaire de vérifier qu’il y ait eu une atteinte à la vie ou aux personnes. Ici, il faudra raisonner sur un profil diagnostic (ce qui s’est produit) et pronostic (ce qui pourrait se produire). Ainsi, la reconnaissance de ce délit sera également concomitante au résultat de délit individuel.
Le Code pénal italien fixe ainsi une série de catastrophes, et à l’article 434 fixe une catastrophe innomée qui sanctionne l’acte destiné à provoquer une catastrophe avec aggravation de la peine en cas de réalisation, et l’article 437 qui est la catastrophe innomée sur le lieu du travail qui sanctionne l’omission, la suppression ou la dégradation destinée à prévenir un accident individuel ou une catastrophe qui là encore est aggravé par la réalisation. Ainsi, le juge a pu estimer que l’on avait affaire à une infraction environnementale, et l’a donc utilisé pour les cas d’exposition à l’amiante, et la surmortalité indiquée dans les études épidémiologiques a suffi. Cet article a aussi été utilisé pour définir l’aspect épidémique, et là encore les données épidémiologiques et les données démographiques ont permis de vérifier cela facilement. En démontrant une incidence avec la pathologie, l’on pourra donc retenir un risque relatif (plus important de développer la pathologie) et le nombre attribuable qui touche à ceux qui ont développé la pathologie. Mais ces données générales restent malgré tout muettes sur les cas individuels, et ne permettent donc pas d’obtenir un lien de causalité.
Il faudra néanmoins que les faits soient caractérisés. Autrement dit, il faudra qu’ils soient impérieux, immédiats, et définis dans un espace spatio-temporel, et donc il y aura une distorsion de l’accident individuel ou collectif. Qui plus est, et contrairement aux autres infractions, les dommages collectifs aux personnes sont constitutifs de l’infraction, et donc, l’on a une forme de distorsion de la notion de désastre.

La fin de table ronde a laissé place à des questions des nombreux participants réunis à cette occasion. Les échanges ont été riches et stimulants.


