Léa FLECK et Erika GRASSO
Etudiantes en Master 2 PJJ, Université de Haute-Alsace
Ce colloque s’est tenu à Mulhouse, à la Fonderie, le 19 septembre 2025, sous la responsabilité scientifique d’Anthony Tardif, Maître de conférences à l’UHA et membre du CERDACC (UR 3992) (Le programme).
Première partie : Approche générale de la responsabilité du fait d’autrui
Cette première partie se déroule sous la présidence de Monsieur Hervé Arbousset (Professeur à l’Université de Haute-Alsace et membre du CERDACC). Il a ainsi initié la journée avec quelques mots d’introduction sur la notion de responsabilité du fait d’autrui et les enjeux que celle-ci pose.
Monsieur le Professeur Arbousset invite alors le premier intervenant à prendre la parole.
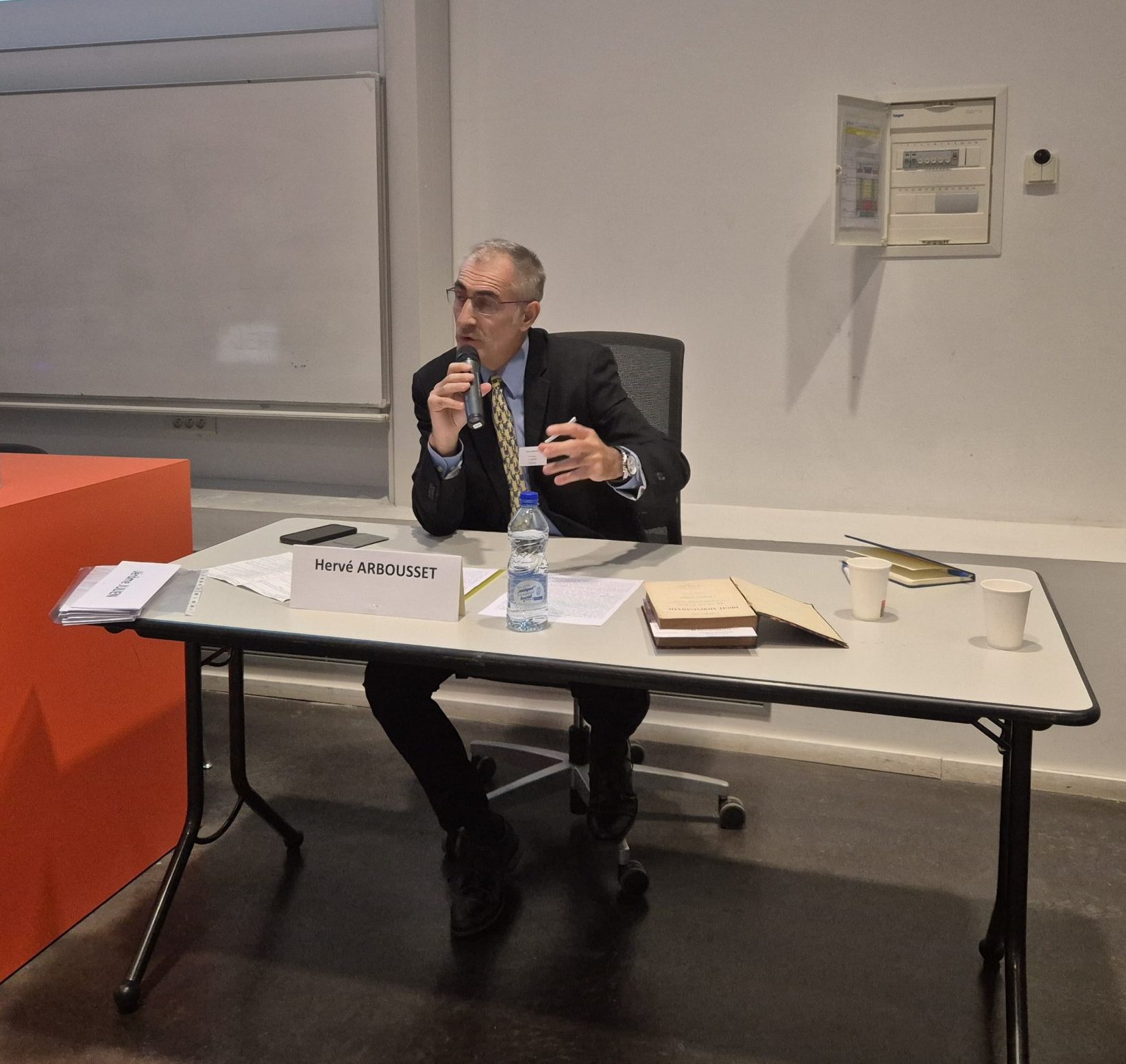
A.- La responsabilité du fait d’autrui en droit civil
1. Approche historique de la responsabilité civile du fait d’autrui
Lors de cette conférence, Monsieur Olivier Descamps (Professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas) rappelle que la responsabilité est au cœur de notre humanité, citant Saint-Exupéry : « l’on est responsable de tout et de tous ». Il retrace l’évolution historique de la responsabilité du fait d’autrui. Le terme « responsable », apparu en 1284, vient du latin et signifie « répondre d’un dommage causé par soi ou par autrui ».
Les premières formes de responsabilité remontent à la Mésopotamie, où elle était solidaire, tandis que la tradition hébraïque individualisait déjà la faute et la peine. Le Professeur Descamps fait un parallèle au droit romain pour lequel la responsabilité était spécifique et souvent fondée sur l’autorité du paterfamilias.
Au Moyen Âge, elle évolue vers une individualisation plus marquée, même si certains cas de responsabilité pour autrui persistent, notamment celle des parents ou celle du mari envers sa femme. À l’époque moderne, des auteurs comme Robert-Joseph Pothier et Jean Domat cherchent à systématiser ces régimes.
Le Code civil de 1804 consacre alors la responsabilité du fait d’autrui, distinguant la faute d’éducation pour les parents et une responsabilité stricte pour les commettants. Au XIXe siècle, la doctrine conceptualise ces règles, mais certaines questions restent en suspens. Les XXe et XXIe siècles voient une unification progressive, avec une objectivation croissante de la responsabilité et un rôle central de l’assurance.
Enfin, le projet de réforme de 2017 et les travaux de Philippe Rémy invitent à revisiter les sources romaines pour repenser la responsabilité contemporaine.

2. La notion de responsabilité civile du fait d’autrui
Lors de son intervention, Monsieur Jérôme Julien (Professeur à l’Université de Toulouse I Capitole) revient sur la notion de responsabilité civile du fait d’autrui, à la fois familière mais théoriquement incertaine. Bien qu’ancienne, elle reste mal comprise, oscillant entre une exception au principe de responsabilité personnelle et un mécanisme autonome. Il a ainsi soulevé la question de son unité conceptuelle : existe-t-il une responsabilité du fait d’autrui unifiée ou seulement une juxtaposition de régimes distincts ?
Historiquement, elle reposait sur la faute, comme en témoigne la rédaction du Code civil de 1804. Le XXe siècle marque une rupture avec l’abandon progressif de la faute comme fondement, notamment pour la responsabilité des commettants et celle des parents, ce qui fragilise la cohérence du système en dissociant l’auteur du dommage du responsable civil.
Un schéma commun subsistait pourtant, fondé sur un fait générateur, un tiers tenu sans possibilité d’exonération, et un recours éventuel. Mais ce schéma est aujourd’hui affaibli par l’évolution divergente des régimes. Responsabilité parentale, responsabilité des commettants ou responsabilité civile du fait d’autrui de droit commun ont suivi des trajectoires distinctes.
Ainsi, la réforme de 2017 visait à clarifier la situation en présentant la responsabilité du fait d’autrui comme une responsabilité indirecte, mais en droit positif, l’incertitude demeure.
Monsieur le Professeur Julien conclut que face à la généralisation de l’assurance et de la mutualisation des risques, l’utilité même de la responsabilité civile pour autrui est aujourd’hui discutée car tout dépend de la fonction qu’on souhaite encore lui attribuer.
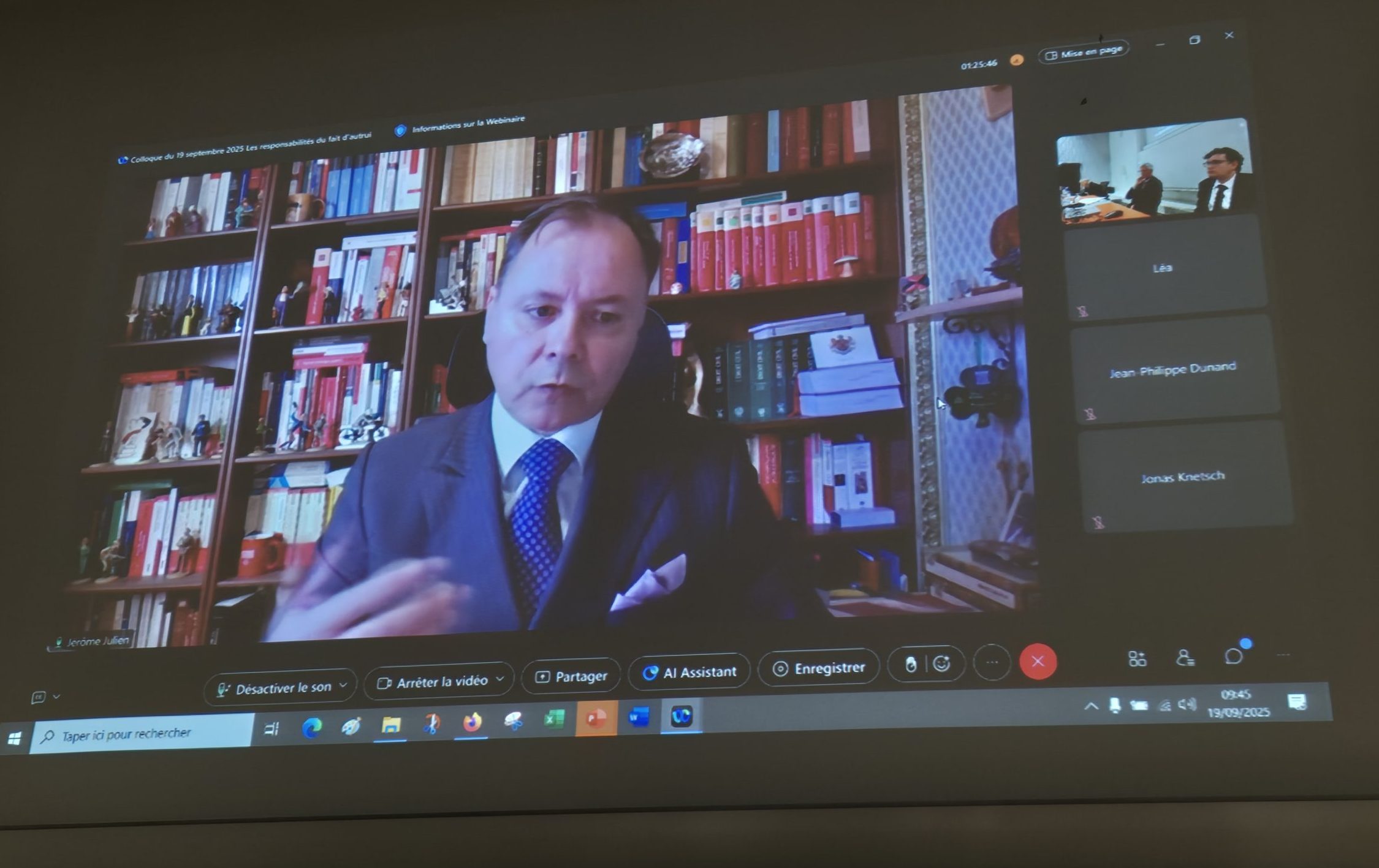
3. Les fonctions de la responsabilité du fait d’autrui
Monsieur Anthony Tardif (Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace et membre du CERDACC) propose une relecture des fonctions de la responsabilité du fait d’autrui à l’ère de l’objectivisation du droit.
Il a ainsi rappelé que si la responsabilité civile du fait d’autrui a longtemps reposé sur la faute (surveillance, éducation), cette justification a été affaiblie, notamment après l’arrêt Bertrand de 1997 qui supprime l’exonération par absence de faute. La responsabilité du fait d’autrui est alors perçue comme une garantie d’indemnisation, mais cette fonction se heurte à la généralisation de l’assurance, qui rend le recours contre l’auteur du dommage souvent inutile ou interdit.
Face à l’érosion de cette fonction traditionnelle, il suggère une nouvelle approche : voir la responsabilité du fait d’autrui comme un mécanisme de protection de la personne placée sous autorité (préposé, enfant mineur, membre d’association). Cette logique se manifeste notamment par l’immunité du préposé ou par la suppression de la condition de cohabitation dans la responsabilité parentale. Il évoque également le refus jurisprudentiel de recours de l’assureur contre des proches de l’assuré.
Dès lors, la responsabilité du fait d’autrui ne viserait plus à punir ou à compenser une faute, mais à protéger l’auteur dépendant. Monsieur Anthony Tardif conclut en proposant d’empêcher le recours du responsable contre l’auteur direct, pour consolider cette fonction protectrice, à l’image du modèle de l’éducation nationale prévu à l’article L. 911-4 du Code de l’éducation.

B.- La responsabilité du fait d’autrui en dehors du droit civil
1. La responsabilité pénale du fait d’autrui
Madame Caroline Teuma (Professeur à l’Université d’Aix-Marseille) rappelle que la responsabilité pénale du fait d’autrui repose sur le principe fondamental selon lequel « nul homme innocent ne peut être puni pour le délit d’autrui ». Ce principe de valeur constitutionnelle et reconnu par la CEDH, est partagé par plusieurs pays européens.
Historiquement, dans les sociétés archaïques, la responsabilité était collective. Mais cette conception a progressivement disparu pour laisser place à une responsabilité strictement individuelle. Aujourd’hui encore, la responsabilité pénale du fait d’autrui est officiellement rejetée en droit français.
En droit positif, la condamnation pénale exige soit d’avoir personnellement commis l’infraction, soit d’y avoir personnellement participé. Ainsi, la responsabilité du complice reste personnelle puisqu’il contribue directement à l’infraction, même s’il ne l’exécute pas lui-même.
De même, la responsabilité du chef d’entreprise ou des personnes morales ne relève pas d’une responsabilité pénale du fait d’autrui car le premier peut être sanctionné pour manquement à son obligation de surveillance, et les secondes ne peuvent agir qu’à travers leurs représentants. De ce fait, cela constitue une responsabilité “avec autrui” et non “du fait d’autrui”.
Cependant, certaines situations récentes s’en rapprochent. Pour les personnes morales, un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 a admis que, lors d’une fusion-absorption, la société absorbante puisse être poursuivie pour des infractions commises par la société absorbée avant l’opération, y compris dans le cas d’une SARL.
Pour les personnes physiques, la responsabilité du chef d’entreprise repose sur une présomption irréfragable de faute, sauf délégation de pouvoirs. Dans les infractions non intentionnelles, comme l’homicide involontaire, un chirurgien peut être condamné pour une erreur commise par son interne, au nom de son devoir de surveillance.
Ainsi, même si la responsabilité pénale du fait d’autrui est théoriquement exclue, certaines évolutions législatives et jurisprudentielles, telles que la proposition de loi d’avril 2024 visant la responsabilité des parents pour les infractions de leurs enfants, montrent une tendance à assouplir ce principe. Cela soulève la question de l’effectivité réelle du principe de responsabilité pénale personnelle.

2. De l’obligation de vigilance de la société mère à la responsabilité environnementale du fait de la filiale
Madame Blandine Rolland (Professeur à l’Université de Haute-Alsace et Directrice du CERDACC) aborde le sujet d’une forme émergente de responsabilité du fait d’autrui : celle des sociétés mères du fait des agissements de leurs filiales, en particulier dans le domaine environnemental. À ce jour, aucun texte légal ne consacre directement ce type de responsabilité. Plusieurs projets, tels que l’avant-projet Catala ou le rapport Terré, ont tenté d’en prévoir l’introduction, mais sans succès.
La seule avancée notable reste la loi du 27 mars 2017, qui impose aux sociétés mères une obligation de vigilance afin de prévenir les atteintes graves à l’environnement et aux droits humains. Toutefois, cette responsabilité demeure strictement personnelle et ne constitue pas une véritable responsabilité du fait d’autrui. Ce dispositif se révèle limité, comme l’a démontré une décision récente du Conseil d’État (CE, 24 juillet 2025), qui a refusé d’engager la responsabilité de l’État pour défaut de surveillance d’une installation classée pour la protection de l’environnement dans l’affaire Metaleurop. L’un des principaux obstacles à la consécration d’une responsabilité des sociétés mères réside dans le principe d’autonomie juridique des personnes morales, réaffirmé par le Conseil constitutionnel qui s’oppose à une responsabilité du fait d’autrui (C. constit., 22 janv. 2016, QPC).
Le Professeur Rolland met en lumière deux grandes interrogations : pourquoi cette responsabilité n’a-t-elle pas encore été reconnue, et comment pourrait-on l’instaurer efficacement afin de renforcer la protection environnementale et la lutte contre les préjudices environnementaux commises par des filiales ? Elle conclut en proposant la création d’un article 1249-1 du Code civil, qui engagerait la société mère automatiquement si toutes les actions contre la filiale échouaient. Cet article commencerait par ces mots : « La société mère est responsable de plein droit des dommages environnementaux causés par sa filiale lorsque celle-ci a fait l’objet de poursuites vaines et préalables … ».

3. La responsabilité administrative du fait d’autrui
Madame Emilie Barbin (Professeur à l’Université de Grenoble-Alpes) traite de la pertinence d’emprunter la notion de responsabilité du fait d’autrui issue du droit civil, afin comprendre et fonder la responsabilité administrative.
Historiquement, certaines situations rappellent la responsabilité civile du fait d’autrui comme la responsabilité de l’administration pour les dommages causés par ses agents. Toutefois, cette analogie reste limitée car elle engage une vision idéologique du droit administratif qui s’est construit en opposition au droit civil. Ce refus d’emprunt a joué un rôle majeur dans la naissance d’un droit administratif autonome, notamment par l’arrêt Blanco de 1873.
Depuis les années 1950, certains auteurs voient la responsabilité administrative comme une forme de responsabilité du fait d’autrui mais René Chapus s’y oppose. En effet, celui-ci affirmait qu’elle devait rester fondée sur des règles spécifiques aux collectivités publiques.
Aujourd’hui, la distinction tend à s’atténuer. À ce titre, le Conseil d’État en 2005 a inauguré un régime de responsabilité du fait d’autrui. Cette analyse reposait sur certaines décisions, comme celle de la cour d’appel administrative de Douai, reconnaissant implicitement des principes proches de la responsabilité civile du fait d’autrui, notamment en matière de responsabilité sans faute pour activités dangereuses.
Ce rapprochement, autrefois perçu comme une menace, est désormais vu de façon plus pragmatique : l’enjeu lié à l’emprunt de la notion de responsabilité du fait d’autrui au droit administratif semble aujourd’hui neutralisé grâce à une approche pragmatique du juge administratif et des membres du Conseil d’État.
Les décisions rendues ne font pas explicitement référence à cette notion ni aux articles du Code civil, mais les rapporteurs publics reconnaissent ouvertement l’inspiration civiliste qui guide certaines solutions.
Ainsi la référence à la responsabilité du fait d’autrui a perdu sa charge idéologique et est désormais mobilisée comme un outil de réflexion, notamment autour de la notion de garde, pour envisager de nouvelles perspectives de responsabilité. Notamment lorsque sont étudiées les perspectives de responsabilité qui pourraient naître de l’usage de l’intelligence artificielle, on retrouve presque systématiquement une référence à la responsabilité du fait d’autrui.
Madame la Professeur Barbin conclut en énonçant que si le risque de perte d’autonomie du droit administratif s’éloigne, cette neutralisation s’accompagne néanmoins d’une réflexion morale, soulignant la nécessité d’encadrer ces évolutions avec prudence.

Deuxième partie : Approche concrète des responsabilités du fait d’autrui
Cette seconde partie est présidée par Monsieur Dariusz Piatek (Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace, et membre du CERDACC).

A.- Les responsabilités du fait d’autrui en droit interne
1. L’évolution de la condition de cohabitation en matière de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
Madame Olivia Robin-Sabard (Professeur à l’Université de Tours, Doyenne de la Faculté de Droit) apporte un éclairage bienvenu sur l’évolution jurisprudentielle et législative relative à la condition de cohabitation.
Désormais l’article 1242, alinéa 4 du Code civil ne prévoit plus la condition de la cohabitation pour engager la responsabilité du parent du fait de son enfant mineur. La cohabitation se déduisait de la résidence habituelle et faisait obstacle à la mise en cause du parent non-résident, ce qui posait des difficultés pratiques en cas de séparation et de résidence alternée. Par un revirement majeur, la Cour de cassation, en Assemblée plénière le 28 juin 2024, a requalifié la condition de cohabitation en la rattachant à l’exercice de l’autorité parentale. Le législateur a ensuite inscrit cette évolution dans la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 (dite « loi Attal »), supprimant la condition de cohabitation dans la nouvelle rédaction de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil. Dorénavant, deux conditions sont attendues : la survenance d’un dommage causé par l’enfant mineur et l’exercice de l’autorité parentale. Cette transformation vise à prendre en compte les réalités de la coparentalité, affirmées dès la loi du 4 mars 2022, selon laquelle les deux parents assument une responsabilité commune qui subsiste après la séparation. Elle met également fin aux inégalités qui frappaient les parents séparés, y compris ceux titulaires d’un simple droit de visite et d’hébergement. Sur le plan pratique, la loi facilite l’indemnisation des victimes en multipliant les débiteurs et les couvertures potentielles. Elle autorise par ailleurs les assureurs à réclamer une participation des parents au remboursement des dommages causés par leur enfant, plafonnée à 7 500 €, après indemnisation intégrale de la victime.
Madame la Doyenne Robin-Sabard conclut que la réforme s’adapte aux réalités familiales contemporaines en renforçant la protection des victimes et en affirmant la volonté de responsabiliser les parents face à la hausse de la délinquance des mineurs.

2. La responsabilité des commettants et les relations triangulaires de travail
Madame Juliette Brunie (Maître de conférences à l’Université de Tours) aborde la question de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, principe classique en droit civil lequel repose sur l’existence d’un lien de subordination. Le contrat de travail en est l’exemple type, mais certaines relations professionnelles s’éloignent de ce schéma classique, notamment dans le cadre de relations triangulaires de travail, où un salarié recruté et rémunéré par un premier employeur, est mis à la disposition d’une autre entité exerçant les prérogatives patronales. Ces situations se rencontrent dans différents contextes : lors d’un travail temporaire via une agence d’intérim, d’un travail à temps partagé pour plusieurs PME, associations intermédiaires favorisant la réinsertion professionnelle, associations de services aux personnes, ou encore groupements d’employeurs à but non lucratif mettant des salariés à disposition d’entreprises pour de courtes missions. Madame Juliette Brunie soulève alors la question de savoir qui est le véritable commettant ? Est-ce l’employeur d’origine, l’entreprise utilisatrice ou les deux ?
La jurisprudence depuis les années 1970 tend à désigner un commettant unique, celui qui exerce en pratique l’autorité au moment du dommage, considérant que la mise à disposition entraîne un transfert d’autorité et donc de préposition.
Toutefois, il peut exister un cumul de commettants, lorsque l’employeur initial conserve certaines prérogatives, notamment la possibilité de sanctionner une mauvaise exécution du travail. Dans ce cas, la condamnation peut être in solidum, afin de protéger la victime contre le risque d’insolvabilité.
Madame Juliette Brunie conclut en rappelant que des clauses contractuelles peuvent prévoir lequel des deux assume la responsabilité, la liberté contractuelle étant reconnue en la matière. En revanche, dans le cadre de la sous-traitance, même si la situation semble proche d’une relation triangulaire, la société donneuse d’ordre n’est généralement pas considérée comme le commettant de la société sous-traitante.

3. Les responsabilités du fait d’autrui innomées
Madame Léa Lucienne (Maître de conférences à l’Université Catholique de l’Ouest) examine la notion de responsabilité du fait d’autrui, en s’interrogeant sur l’existence d’un principe général à ce sujet.
Deux courants de pensée se dessinent parmi les juristes. D’un côté, certains justifient l’établissement d’un principe général de responsabilité. Ceux-ci mettent en avant des critères d’administration et une volonté de limiter les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité, notamment en considérant la garde d’autrui dans la gestion des activités.
De l’autre côté, une partie des juristes conteste ce principe, arguant que l’article 1242 du Code civil ne constitue qu’un cadre procédural sans portée normative, lequel ne s’impose pas en tant que norme générale. Ils soulignent l’absence de fondements juridiques clairs pour une responsabilité au fait d’autrui et distinguent la notion de garde de celle du contrôle exercé par des entités comme les associations sportives sur leurs membres.
Madame Léa Lucienne se penche également sur les éléments constitutifs des principes de droit privé, insistant sur la nécessité d’une autorité supérieure pour ces normes.
Parallèlement, la discussion explore la relation entre les cas spéciaux de responsabilité et un éventuel principe général, suggérant que la reconnaissance d’une responsabilité générale du fait d’autrui pourrait en réalité englober une multitude d’autres responsabilités.
Madame Léa Lucienne conclut en mettant en lumière l’importance de déterminer si ces responsabilités spécifiques relèvent d’un mécanisme général ou peuvent être analysées de manière isolée, ce qui pourrait influencer l’interprétation des obligations et la jurisprudence future.
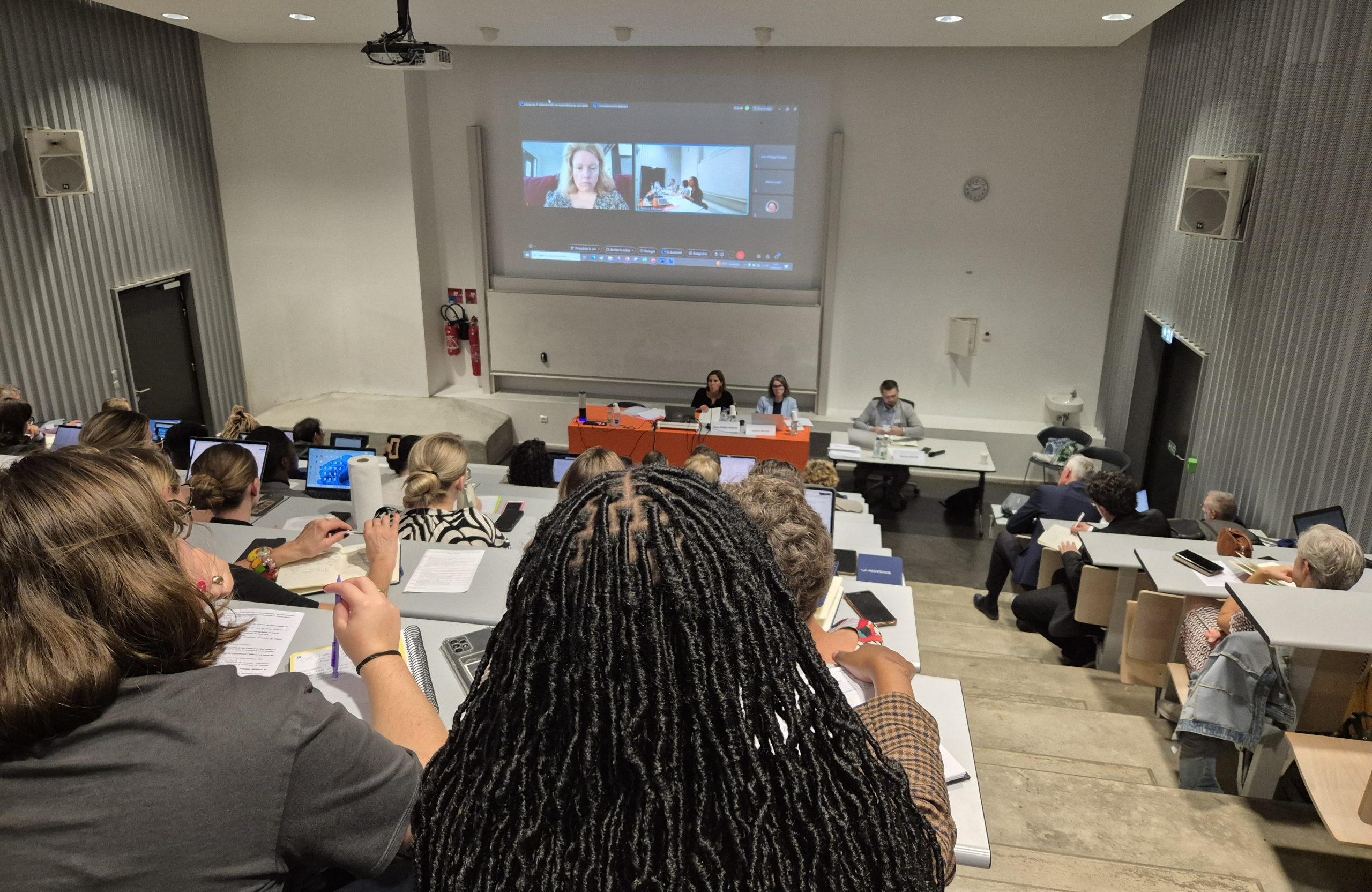
B.- Les responsabilités du fait d’autrui dans les pays étrangers
1. Morceaux choisis touchant la responsabilité du fait d’autrui en droit québécois
Monsieur Daniel Gardner (Professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval) traite des divergences rencontrées entre le droit québécois et le droit français, appuyant notamment sur le mécanisme de l’assurance.
Le droit québécois diffère du droit français en ce qu’il cherche davantage à protéger le gardien d’autrui, notamment grâce au mécanisme de l’assurance, tandis qu’en droit français, l’accent est plus largement mis sur la protection de la victime.
Concernant le mineur, la cohabitation n’a jamais été une condition. Depuis 1994, le droit québécois ne retient que l’autorité parentale, qu’il s’agisse d’une autorité de fait ou de droit, ce qui signifie que tout gardien même ponctuel peut être concerné. Il ne s’agit pas d’une responsabilité de plein droit, mais d’une présomption de faute dont il est assez facile de s’exonérer. Ce mécanisme est renforcé par le rôle de l’assurance, qui indemnise la victime, évitant de poursuivre directement les parents. Ce n’est donc pas les parents qui répondent mais l’assureur qui prend en charge l’indemnisation des dommages causés par les enfants.
Le législateur prévoit un régime favorable aux gardiens qui interviendrait à titre gratuit ou rémunéré. Cela concerne par exemple les grands-parents ou les baby-sitters, pour lesquels la présomption de faute ne s’applique pas et pour lesquels il faudra démontrer une faute, ce qui est difficile en pratique. Pour les tuteurs et curateurs d’une personne majeure, la responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute intentionnelle ou lourde. De même, pour le commettant, la responsabilité est en principe couverte par l’assureur, qui ne peut exercer de recours contre l’employeur.
Monsieur le Professeur Gardner conclut que le droit québécois privilégie la protection du gardien d’autrui et mise sur l’assurance pour indemniser les victimes, contrairement au droit français qui place la victime au centre de la responsabilité.
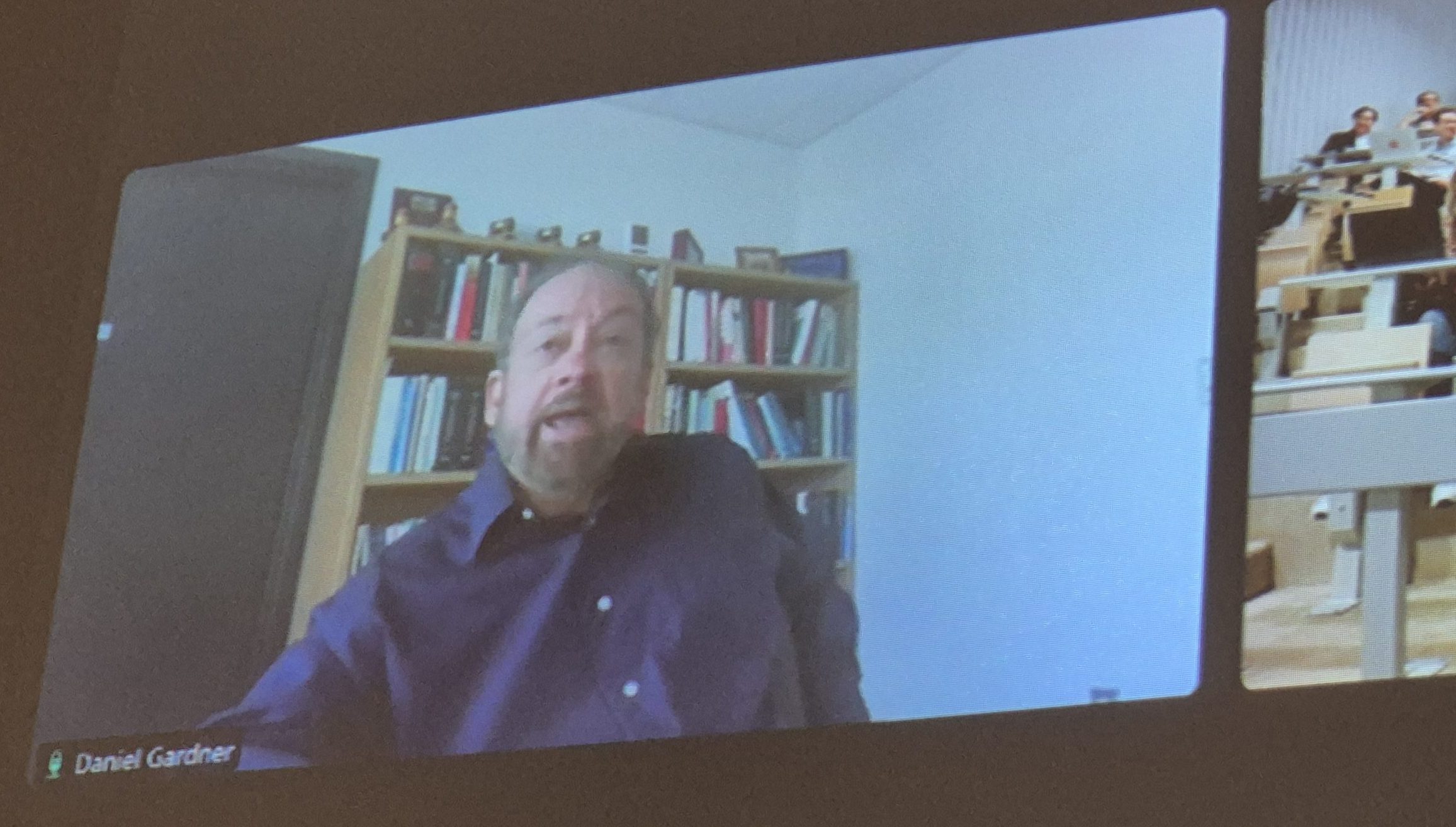
2. Quel fondement pour la responsabilité du commettant ? Réflexions à partir des droits allemand et anglais
Monsieur Jonas Knetsch (Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) interroge le fondement de la responsabilité du commettant à la lumière des droits allemand et anglais. Cette question soulève à la fois des enjeux économiques et permet de mettre en évidence des divergences fortes.
En droit allemand, la responsabilité repose sur une présomption de faute, que le commettant peut renverser en démontrant son absence de négligence. Cette possibilité d’exonération, renforcée par la théorie de « l’exonération décentralisée », facilite la défense des entreprises et limite leur responsabilité. La Cour fédérale de justice exige toutefois des standards de vigilance très élevés, transformant en pratique cette présomption de faute en quasi-responsabilité objective. Le droit du travail accentue ce mouvement, puisque le salarié peut demander à être garanti par son employeur, ce qui conduit indirectement à une responsabilité sans faute de ce dernier.
A l’inverse, en droit anglais, la responsabilité du commettant, historiquement fondée sur la faute, a évolué vers un régime sans faute depuis le XIXe siècle. L’idée est que celui qui bénéficie de l’activité du préposé doit assumer le risque, quitte à répercuter le coût sur l’assurance ou sur le prix des biens et services. Le champ d’application a été élargi avec le critère de « connexité ». En effet, l’employeur peut être tenu même pour des actes graves commis par son préposé s’ils sont liés à ses fonctions, comme les abus de pouvoir par exemple.
Ainsi, le droit allemand et le droit anglais apparaissent comme deux « anomalies » dans leurs systèmes respectifs (civiliste et common law), mais leurs évolutions jurisprudentielles tendent paradoxalement à rapprocher leurs régimes de celui du droit français.

3. La responsabilité du fait d’autrui en droit polonais
Monsieur Fryderyk Zoll (Professeur à l’Université Jagellon de Cracovie), et Monsieur Maciej Bujalski (Doctorant à l’Université Jagellon de Cracovie) présentent une analyse de la responsabilité du commettant en droit polonais, en soulignant ses convergences et spécificités par rapport au modèle français.
En droit polonais, la responsabilité du commettant repose principalement sur l’article 430, proche du droit français, et prévoit que l’employeur ou supérieur doit répondre du préjudice causé par son préposé dans l’exercice d’une tâche confiée. Deux régimes coexistent : un régime sans faute, similaire à la responsabilité classique du commettant français, et un régime hybride prévu à l’article 429, où la responsabilité pour faute s’applique lorsque la tâche est confiée sans lien hiérarchique direct. Ce régime permet au commettant de s’exonérer dans certains cas, par exemple lorsqu’il a confié la tâche à un professionnel compétent.
Ils concluent que la structure polonaise combine ainsi protection du supérieur et indemnisation des victimes, tout en introduisant des nuances par rapport au modèle français classique.

4. La responsabilité du fait d’autrui en droit suisse
Monsieur Jean-Philippe Dunand (Professeur à l’Université de Neuchâtel) aborde les principes généraux de la responsabilité du fait d’autrui et leurs applications pratiques en droit du travail.
En droit suisse, la jurisprudence occupe une place prépondérante parmi les sources du droit, notamment en matière de harcèlement sur le lieu de travail. Il n’existe aucune disposition légale régissant expressément la responsabilité de l’employeur pour les actes de harcèlement commis par ses salariés. C’est donc la jurisprudence qui en a progressivement tracé les contours, en distinguant d’abord le harcèlement psychologique du harcèlement sexuel. Concernant le harcèlement psychologique, aussi communément appelé mobbing, la responsabilité de l’employeur peut être engagée sur le plan contractuel et délictuel, mais uniquement lorsque l’auteur du harcèlement occupe une position hiérarchique supérieure à la victime. En revanche, si le harcèlement se produit entre collègues de même niveau horizontal, l’employeur n’est en principe pas responsable. En cas de harcèlement sexuel, la responsabilité de l’employeur ne sera pas recherchée s’il réussit à démontrer qu’il a pris des mesures préventives et correctrices adéquates. Cette preuve libératoire est en réalité assez facile à établir. Par ailleurs, l’indemnisation pour harcèlement sexuel est limitée à six mois de salaire moyen contrairement au harcèlement psychologique qui ne connait pas de plafond.
Dès lors, conclut Monsieur le Professeur Dunand, la distinction selon la hiérarchie de l’auteur et le type de harcèlement illustre l’importance de la jurisprudence dans l’interprétation et l’application du droit suisse.
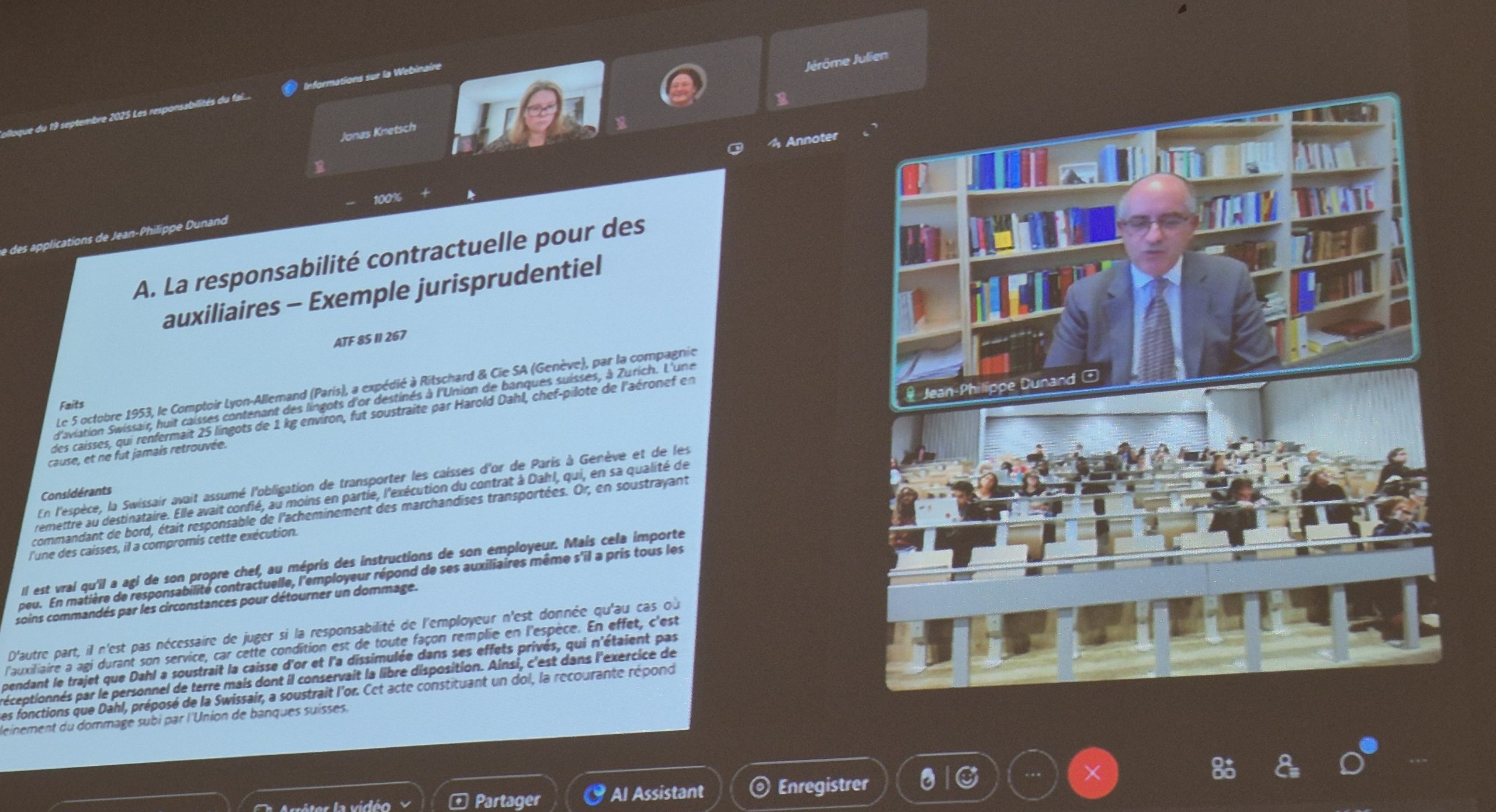
5. La responsabilité du fait d’autrui en droit espagnol
Monsieur Ricardo Pazos Castro (Professeur à l’Université Pontificale Comillas de Madrid) propose une analyse du sujet sous le prisme du droit espagnol.
En Espagne, l’article 1903 du Code civil constitue l’équivalent de l’article 1242 du Code civil français. Il énumère cinq hypothèses de responsabilité du fait d’autrui : les parents, les tuteurs, les curateurs, les commettants et les établissements d’enseignement. La liste est en principe fermée, mais la doctrine admet parfois une interprétation large de ces catégories.
Concernant les parents, le droit espagnol n’exige plus la condition de la cohabitation depuis 1981, le critère étant celui de l’autorité parentale. Il existe une distinction entre la titularité et l’exercice de l’autorité parentale. En cas de mariage, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur se base sur la titularité de l’autorité parentale. En cas de séparation, c’est le parent gardien qui répond, sauf si le dommage survient pendant le droit de visite de l’autre parent. Les tuteurs répondent, sous réserve de la condition de cohabitation qui persiste en la matière. Les curateurs, en revanche, ne répondent que s’ils disposent de la représentation totale et cohabitent avec la personne assistée. A défaut, leur responsabilité suppose la preuve d’une faute. En effet, depuis la réforme de 2021, les personnes incapables répondent des dommages qu’elles causent. Auparavant, la notion de discernement était requise.
En ce qui concerne les commettants du fait de leurs préposés, il y a une interprétation très large autour de ces deux notions. La jurisprudence espagnole considère que si le préposé agit en dehors de ses missions, le commettant ne répond pas, mais lorsque le dépassement n’est pas significatif, la responsabilité du commettant sera recherchée. Il dispose néanmoins d’une action en répétition. L’idée étant de s’assurer de la prudence du préposé. A l’inverse, les établissements d’enseignement ne peuvent se retourner contre le personnel qu’en cas de faute lourde ou agissement dolosif. Ce qui marque une différence très claire par rapport aux commettants.

Rapport de synthèse
Monsieur Fabrice Leduc (Professeur émérite à l’Université de Tours) conclut ce colloque sur la responsabilité du fait d’autrui en présentant un rapport de synthèse de toutes les interventions.
Il rappelle ainsi que la responsabilité du fait d’autorité repose sur une relation triangulaire entre une victime, l’auteur direct du dommage et une personne ou entité exerçant une autorité sur cet auteur.
Elle se distingue de la responsabilité du fait personnel et de la simple garantie du fait d’autrui, car elle repose sur une responsabilité objective, indépendante de la faute. En matière délictuelle, elle implique que la personne responsable ait un véritable pouvoir de contrôle sur l’auteur du dommage.
En revanche, dans le domaine contractuel, elle est plus limitée et concerne principalement le débiteur ou la garantie d’un autre contractant.
Le Professeur Leduc souligne la possibilité, encore discutée, pour le responsable de s’exonérer totalement en cas de force majeure, à condition de prouver qu’un événement extérieur et imprévisible l’a empêché d’exercer son autorité. Cette exonération reste toutefois rarement admise, notamment pour la responsabilité des commettants envers leurs préposés.
L’utilité de cette responsabilité est aujourd’hui remise en question en raison du développement de la solidarité nationale et des assurances de responsabilité, qui permettent déjà d’indemniser les victimes. Elle tend donc à ne jouer un rôle significatif que pour les dommages mineurs.
Un paradoxe apparaît : la jurisprudence élargit les conditions d’engagement de la responsabilité du fait d’autrui, tout en réduisant sa réelle efficacité pour protéger les victimes.
Il conclut en apportant une nouvelle perspective dans laquelle la responsabilité aurait pour fonction principale de protéger les primo-responsables, en orientant les poursuites vers ceux qui détiennent une autorité sur eux. Cependant, cette approche reste éloignée du cadre juridique actuel.



