Claude LIENHARD
Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,
Professeur émérite de l’Université Haute-Alsace,
Directeur honoraire du CERDACC (UR 3992)
et
Catherine SZWARC
Avocate spécialisée en droit du dommage corporel
I.- Droit du dommage corporel
1. La preuve d’une assistance par une tierce personne pour la scolarité : seul comptent les besoins
Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 04/07/2025, 471282 A LIRE ICI
Une victime ayant développé une narcolepsie après une vaccination contre la grippe A, demandait la prise en charge de frais d’assistance scolaire. L’ONIAM avait été condamné à payer une rente annuelle pour l’aide d’une tierce personne et à rembourser, sur justificatifs, des frais d’aide scolaire. La cour d’appel avait refusé le remboursement faute de justificatifs établissant l’engagement effectif des frais.
Le Conseil d’Etat, qui annule la décision rappelle que l’indemnisation doit tenir compte exclusivement des besoins avérés de la victime. La justification par factures n’est pas la condition pour bénéficier d’une rente au titre de l’assistance par tierce personne : la cour ne peut donc subordonner ce versement à la seule production de pièces justificatives. Ce rappel est pertinent.
2. Trauma de guerres et conflits
Comme souvent les guerres et conflits confrontent à des situations hors normes dont les enseignements sont porteurs de nouvelles approches.
Médecine de guerre israélienne : le défi du traumatisme invisible
La médecine militaire israélienne met en avant les progrès constants réalisés dans la prise en charge des blessures physiques des soldats, notamment l’optimisation des délais d’évacuation et l’innovation médicale sur le terrain. Mais, elle insiste sur le fait qu’un défi majeur persiste : la gestion des blessures psychiques, en particulier le traumatisme psychologique et le syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qui touche de nombreux soldats après les combats. Depuis le début de la guerre, des milliers de soldats souffrent de détresse psychique, illustrée notamment par le recours massif aux antidépresseurs et la stigmatisation persistante de ces troubles. Malgré les innovations, l’armée israélienne peine à répondre efficacement au flux croissant de patients atteints de traumas psychiques, ce qui se traduit par des difficultés d’adaptation, des suicides et une réhabilitation souvent incomplète.

Procès des revenantes de Daech : traumas lourds chez les enfants rapatriés
L’article sur le procès des revenantes de Daech s’attarde sur les situations de mineurs rapatriés de Syrie après avoir vécu sous l’État islamique. Ces enfants ont été exposés à des violences extrêmes : endoctrinement, abus physiques et sexuels, privations, déplacements constants, vie dans des camps de rétention et confrontation régulière à la mort et à la terreur. Les témoignages d’éducatrices et de psychologues décrivent une accumulation de traumatismes : souvenirs douloureux, troubles anxieux, comportements violents ou sexualisés, difficultés relationnelles et défiance envers les parents ou l’autorité. L’article met aussi en lumière le travail de résilience : accompagnement éducatif, suivi psychologique intensif, capacité d’adaptation. Certains enfants trouvent un certain équilibre et parviennent à se reconstruire, d’autres restent marqués par des séquelles profondes, souvent tues ou inavouables, qui nécessitent un suivi sur le long terme. (A LIRE ICI)
Points communs et spécificités
- Dans les deux articles, il apparaît que la blessure psychique — qu’elle concerne des soldats ou des enfants revenus de zones de guerre — reste particulièrement complexe à dépister, à nommer et à traiter.
- Les professionnels saluent la capacité de résilience de certains mais insistent sur la grande difficulté à mettre en place un accompagnement adapté, par manque de moyens ou face à l’ampleur du traumatisme subi.
- L’enjeu central est la reconnaissance d’un traumatisme souvent invisible, qui s’installe durablement et ne se résout pas sans aide ciblée, pouvant aller jusqu’à la chronicisation ou au passage à l’acte autodestructeur.
3. Pension d’invalidité pas d’imputation sur le DFP
Cour de Cassation Arrêt du 7 mai 2025, n° 23-14.065 A LIRE ICI
La pension d’invalidité ne peut pas être imputée au déficit fonctionnel permanent (DFP). Selon la Cour de cassation (), la pension d’invalidité indemnise exclusivement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, mais pas le DFP. Par conséquent, une cour d’appel ne peut déduire la pension d’invalidité du poste de déficit fonctionnel permanent, ni de celui de l’incidence professionnelle.
II.- Droit des victimes
1.Des pôles victimes à Grasse
La création prochaine de trois pôles dédiés à l’accompagnement des victimes dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, sous l’impulsion du procureur Éric Camous est intéressante.
Cette expérimentation commencera à Antibes et vise à offrir un soutien de proximité aux victimes pour éviter des situations de maltraitance. Les pôles rassembleront des équipes pluridisciplinaires, harmonisant leurs méthodes afin d’assurer un suivi personnalisé, notamment pour les victimes qui ont du mal à poursuivre leurs démarches ou sont confrontées à des problématiques particulières (identitaires, communautaires, religieuses).
Le dispositif vise également à éviter que les victimes aient à se déplacer loin de leur domicile pour trouver du soutien. L’association Harpèges, déjà active dans la région, jouera un rôle clef dans ce réseau. Enfin, cette initiative s’inscrit dans une dynamique nationale, inspirée d’expérimentations similaires menées ailleurs en France, et entend renforcer la synergie entre les partenaires agissant dans le champ de l’accompagnement des victimes.

2. Encore des réformes de procédure pénale concernant les victimes et aussi des propositions
L’évolution du statut et du rôle des victimes dans la procédure pénale française, à la lumière des réformes récentes et d’un projet de loi présenté en juillet 2025 suscite des réactions et des propositions.
Deux mesures marquent une avancée notable : l’obligation d’informer la partie civile d’un appel pénal (même hors appel civil), ainsi que la possibilité de faire entendre la victime comme témoin en appel, même si ses intérêts civils ne sont plus en cause. Cette reconnaissance symbolique et technique reflète un changement de paradigme dans la perception de la victime, d’abord reléguée au second plan, mais désormais considérée comme un participant essentiel à la recherche de la vérité en justice.
Matthieu Bourrette, avocat général à la Cour de Paris, met en garde contre l’excès : donner trop de pouvoir décisionnel à la victime risquerait de déséquilibrer le système et d’entraîner une confusion entre intérêts publics et individuels A LIRE ICI.
Le projet de loi SURE, visant des sanctions rapides et efficaces, propose notamment une procédure de « plaider-coupable » pour certains crimes, subordonnée à l’absence d’opposition de la victime. Cette évolution serait inédite, la voie juridictionnelle n’ayant jamais été jusque-là conditionnée à l’accord de la victime, sauf exceptions (correctionnalisation). Or, une telle participation pourrait aboutir à des blocages, conflits d’intérêts entre victimes multiples, ou à un mélange des genres entre sanction publique et revendications privées.
Il est également suggéré une alternative : renforcer les droits des victimes via l’aide juridictionnelle garantie à la partie civile lors d’un plaider-coupable criminel, afin d’éviter d’en faire artificiellement un « ministère public bis ». Ce dispositif renforcerait l’accompagnement des victimes sans remettre en cause le rôle central du ministère public, pilier de l’action publique pénale.
En conclusion, il insiste pour que la justice ne devienne pas « la chose des parties », au détriment de l’intérêt général, et que le renforcement des droits des victimes s’accompagne d’une réflexion sur l’équilibre et l’efficacité de la procédure, sans confusion des rôles.Le débat est loin d’être clos.
III.- Victimologie
1. Un film à voir : ceci est mon corps
« Ceci est mon corps » de Jérôme Clément-Wilz, centré sur son parcours de victime d’un prêtre d’Orléans condamné en 2024 pour des viols commis sur mineurs.
Parcours de la victime et sens du documentaire
Jérôme Clément-Wilz a été abusé sexuellement entre ses 8 et 15 ans par le prêtre Olivier de Scitivaux, recteur de la basilique de Cléry-Saint-André. Ce n’est qu’une vingtaine d’années après les faits, en 2018, qu’il entame des démarches judiciaires et filme son parcours pour la réalisation d’un documentaire diffusé sur Arte. Il explique avoir voulu documenter l’évolution d’une victime en quête de vérité et la difficulté à briser le silence face à des traumatismes niés ou effacés par l’amnésie dissociative.
Blocages et processus de réparation
La difficulté à dénoncer ou même nommer les faits découle en partie des mécanismes de protection psychique et du silence de l’entourage, parfois familial et ecclésial. Jérôme Clément-Wilz revient sur l’importance que la trace écrite ou filmée peut avoir dans la reconstruction et la lutte contre l’impunité, tout en soulignant que ce cheminement reste marqué par la douleur. Le documentaire montre que le véritable travail de mémoire exige de sortir du déni et de briser l’isolement.
Responsabilités du clergé et de l’institution
Le film interroge la responsabilité de l’Église et de l’évêché, qui ont laissé se perpétuer des faits criminels malgré des signaux d’alerte, en organisant parfois la mutation des prêtres plutôt que leur dénonciation. Les articles rappellent que ce cas n’est pas isolé : de nombreux prêtres ont pu poursuivre des agissements similaires grâce aux carences institutionnelles. L’œuvre de Jérôme Clément-Wilz s’inscrit dans une démarche de lutte contre l’impunité et de soutien aux victimes, en provoquant une prise de conscience sur la gravité des crimes couverts par le silence ecclésial.
Impact et portée
Le film, très personnel, a aidé Jérôme Clément-Wilz à ne pas rester seul dans son combat. Sa démarche contribue à la reconnaissance de la parole des victimes et à la mémoire collective. Il interroge aussi la notion de courage et la difficulté pour la société d’accueillir la souffrance des personnes agressées. Enfin, il met en lumière le besoin de soutien politique et judiciaire pour que justice soit rendue et que la vérité sorte au grand jour.
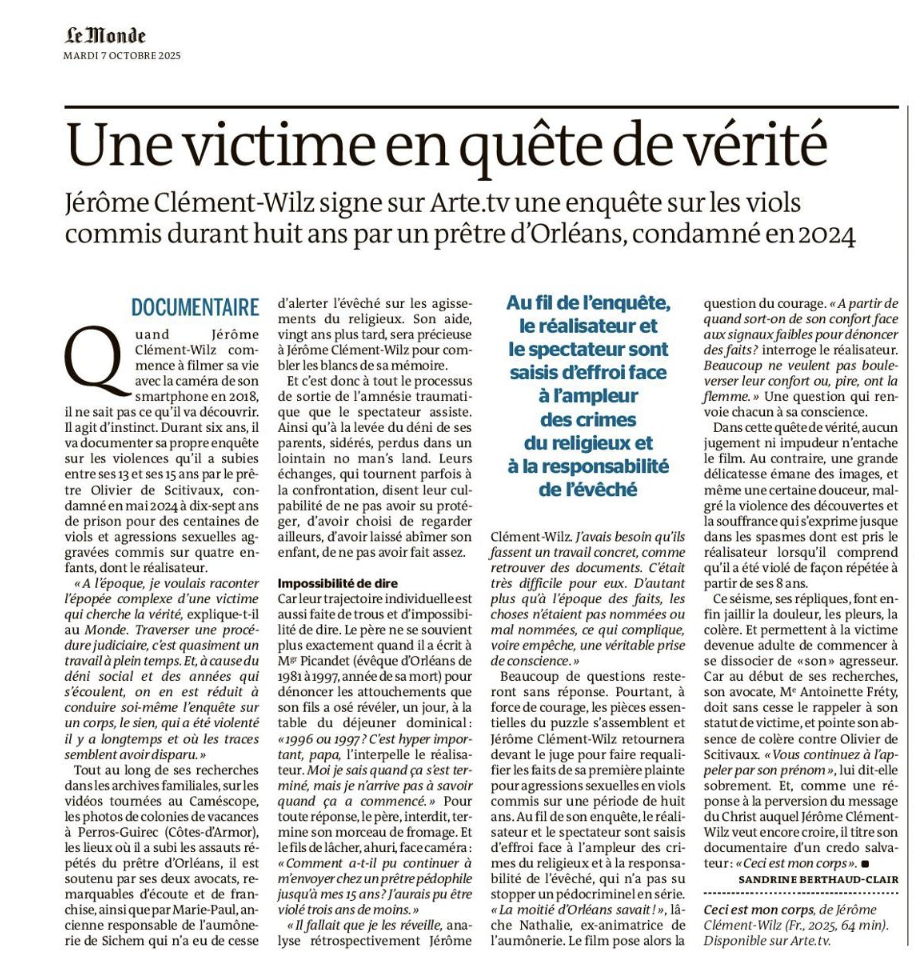

2. La tragédie ferroviaire grecque
Mobilisation et indignation des familles
Des milliers de personnes manifestent à Athènes pour demander justice après l’accident ferroviaire survenu le 28 février 2023, qui a coûté la vie à 57 personnes, majoritairement jeunes. Les familles des victimes expriment leur frustration face à la gestion de la catastrophe et au manque d’avancées judiciaires, estimant que la vérité n’est pas encore établie et que les responsables n’ont pas été sanctionnés.
Suspicion et lenteur judiciaire
L’enquête, officiellement close en août, est sérieusement contestée par les familles : prélèvements essentiels n’ont pas été réalisés, le train aurait été déplacé trop tôt, et les analyses toxicologiques sur les victimes n’ont pas été menées. De plus, la présence éventuelle de substances illégales n’a pas pu être établie, contribuant à renforcer le sentiment d’opacité et d’injustice.
Actions symboliques et soutien
Plusieurs proches ont entamé une grève de la faim pour exiger la vérité et la justice, transformant la place Syntagma en lieu de solidarité et de revendication. Des artistes et responsables politiques de l’opposition apportent également leur soutien aux familles endeuillées.
Exigence de justice
Les familles insistent : elles ne réclament pas une faveur, mais que justice soit rendue, que la vérité éclate et que les responsables soient condamnés. Malgré les manifestations répétées, elles craignent que leurs demandes ne soient pas entendues par le gouvernement conservateur grec en place.
Ce mouvement de colère montre la profondeur du traumatisme collectif et la persistance de la quête de vérité et de justice après la tragédie.

IV.- Violences routières
L’alcool reste une cause essentielle et récurrente des accidents mortels. En voici quelques traçabilités bienvenues.
1.Complicité du vendeur d’alcool
La condamnation définitive de Lidl pour avoir vendu de l’alcool à un mineur décédé ensuite dans un accident de scooter à Urrugne en 2021 est désormais définitive. La société doit payer une amende de 5 000 € et verser 2 500 € à une association de prévention en alcoologie.A LIRE ICI
Décision judiciaire et faits
- La Cour de cassation confirme la condamnation en appel de juillet 2024.
- Le mineur de 16 ans avait pu acheter de la vodka dans un magasin Lidl avec un autre mineur, sans que le personnel vérifie leur âge.
- Le jeune, après avoir consommé l’alcool, est décédé dans un accident de scooter causé par un ami également alcoolisé, reconnu coupable d’homicide involontaire.
Failles de contrôle et responsabilité
- Les juges ont reproché à Lidl de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour contrôler l’âge de ses clients lors de la vente d’alcool, ce qui constitue une « violation en connaissance de cause » de la loi interdisant la vente d’alcool aux mineurs.
- L’employé en caisse n’avait pas reçu pour consigne de vérifier systématiquement l’âge lors d’achat d’alcool.
2. Homicide involontaire et condamnation de la gérante de bar
Une gérante de bar a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Reims, le 30 septembre 2025, pour avoir servi de l’alcool à un homme manifestement ivre, qui est décédé par la suite avec un taux d’alcool de 3,9 g par litre de sang.A LIRE ICI
Faits et circonstances
- Les faits remontent à 2015 : la prévenue, alors âgée de 29 ans, avait servi un « mètre de Ricard » à un habitué de son bar déjà en état d’ébriété avancée.
- Plusieurs témoignages et vidéosurveillance attestent de l’état d’ivresse de la victime à son entrée dans l’établissement.
- Au lieu d’appeler les secours lorsque l’état du client s’est dégradé, la gérante a contacté son père qui a transporté la victime à la clinique, où ce dernier est décédé.
- L’autopsie a révélé un taux d’alcoolémie de 3,9 g/l, largement supérieur au seuil de coma éthylique fixé à 2 g/l.
Motifs juridiques et décision
- La prévenue était poursuivie pour homicide involontaire par imprudence et manquement aux obligations prévues par l’article 221-6 du code pénal, ainsi que par l’article R3353-2 du code de la santé publique interdisant de servir de l’alcool à une personne manifestement ivre.
- La procureure a demandé la reconnaissance de la responsabilité de la gérante, rappelant l’obligation légale de ne pas servir d’alcool à une personne en état d’ébriété manifeste.
- La défense a souligné que la jeune femme n’avait pas clairement identifié l’état d’ébriété de son client et a insisté sur les séquelles psychologiques de la prévenue et son casier judiciaire vierge.
Sanction et suites
- Le tribunal a confirmé la demande du parquet : quatre mois de prison avec sursis.
- Une audience sur les intérêts civils est prévue le 4 juin 2026, concernant le préjudice subi par la famille de la victime.
Cette affaire illustre la responsabilité pénale des gérants de bars en cas de fourniture d’alcool à des clients manifestement ivres et les conséquences tragiques pouvant en résulter.
3.Durcissement
On relève un durcissement marqué des juges à l’égard des auteurs de violences routières, avec des décisions plus fortement répressives à l’encontre des conducteurs responsables d’accidents graves ou mortels.
Sévérité accrue des peines
Dans l’affaire de Moncayolle, le conducteur, impliqué sous l’emprise de stupéfiants dans une collision mortelle ayant causé la mort d’une septuagénaire et de graves blessures à deux autres victimes, a été condamné à sept ans de prison ferme. Le tribunal a retenu sa récidive et son comportement particulièrement dangereux (excès de vitesse, conduite sous drogues) pour justifier une peine significative et le maintien en détention immédiate. Le discours des magistrats et avocats souligne une volonté de reconnaissance de la gravité des faits et de la responsabilité du condamné, refusant l’argument de la fatalité avancée par la défense.
Incarcération immédiate et contrôle judiciaire renforcé
Dans l’autre cas, à Fougères, la cour d’appel de Rennes a ordonné la détention provisoire du chauffard ayant tué une jeune cycliste, malgré une première décision de contrôle judiciaire. La justice a suivi les réquisitions du parquet général, tenant compte du passif du conducteur (antécédents d’alcool, conduite sans permis, délits de fuite), de la dangerosité du comportement routier, et du risque de réitération. Les juges n’hésitent plus à prononcer des mandats de dépôt et incarcérations immédiates pour garantir la sécurité publique et répondre à l’émotion sociale provoquée par ces drames répétés. A LIRE ICI
Durcissement du traitement judiciaire
Le discours judiciaire s’est ouvertement durci : les magistrats insistent sur le caractère inexcusable et quasiment « impardonnable » des faits de violences routières, répriment plus fermement les délits de fuite, refusent la minimisation des responsabilités et s’appuient sur les antécédents et le contexte pour justifier des mesures privatives de liberté dès l’instruction du dossier. Cette nouvelle sévérité traduit une volonté d’exemplarité et d’effet dissuasif, renforçant le sentiment d’une tolérance zéro face aux infractions routières conduisant à la mort ou au handicap de victimes innocentes.
En synthèse, ces deux décisions judiciaires témoignent d’une inflexion vers des sanctions lourdes et immédiatement lisibles contre les auteurs de violences routières, tant au niveau des peines prononcées que des mesures conservatoires (incarcération provisoire), reflétant un mouvement de fond dans la politique pénale actuelle.


