Claude LIENHARD
Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,
Professeur émérite de l’Université Haute-Alsace,
Directeur honoraire du CERDACC (UR 3992)
et
Catherine SZWARC
Avocate spécialisée en droit du dommage corporel
I.- Droit du dommage corporel
A.-Transaction et aggravation situationnelle
(2ème chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-21.571) A LIRE ICI
Par cet arrêt la Cour de cassation reconnait la possibilité d’une indemnisation complémentaire quand des circonstances nouvelles, telles que la naissance d’un enfant, créent un besoin nouveau, même après une transaction antérieure, indépendamment de l’état séquellaire initial. En l’occurrence l’enjeu concernait l’assistance d’une tierce personne.
B.-La nomenclature Dintilhac a 20 ans d’âge
Une intéressante étude, sous la plume de Guillemette Wester, parue au Recueil Dalloz, met en valeur la vertu fédératrice de la nomenclature, mais invite à l’actualiser régulièrement à l’aide de la jurisprudence, pour mieux harmoniser l’interprétation des postes comme l’assistance tierce personne ou le préjudice d’agrément, dont les définitions jurisprudentielles sont plus larges que celles du texte initial. Elle critique les dissymétries temporelles (certains postes se limitent à une phase, d’autres non), causes de difficultés d’évaluation et propose d’instaurer une continuité temporelle plus cohérente.
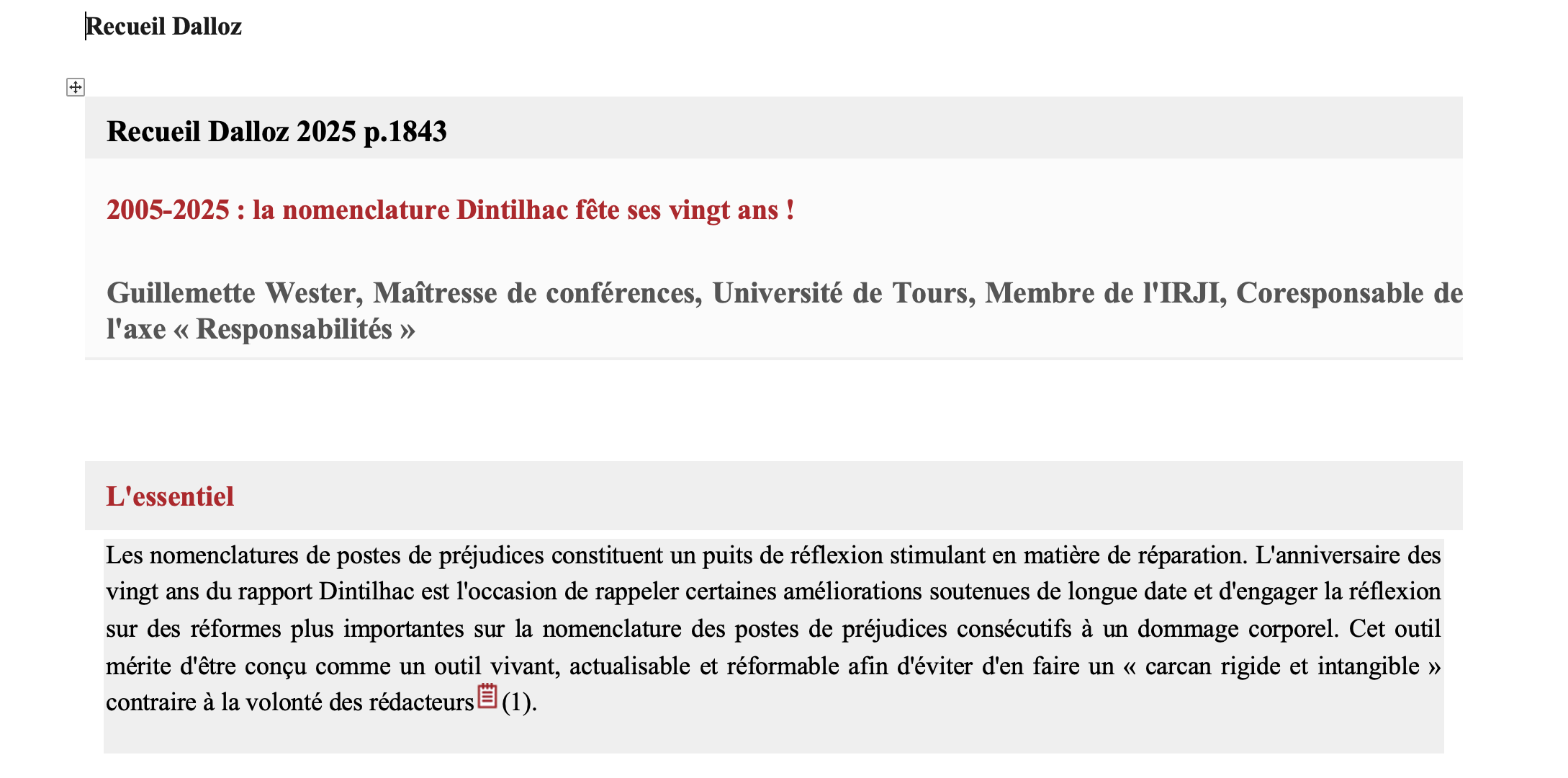
II.- Droit des victimes
A- Les enjeux de l’affaire Le Scouarnec en matière de préjudice
Les principaux enjeux en termes de préjudice dans le procès civil lié à l’affaire Le Scouarnec sont la fixation et la reconnaissance des différents types de préjudices subis par les victimes avec des approches spécifiques concernant le préjudice sexuel, juvénile et psychologique et les préjudices des familles dont des proches se sont suicidés.
On prendra connaissance avec intérêt de la décision attendue pour le 4 janvier 2026.

B.- Aide aux victimes une circulaire de recadrage
La circulaire du 13 octobre 2025 du Garde des Sceaux relative à l’accueil et l’amélioration de la prise en charge des victimes traduit clairement une volonté de recadrage et de contrôle renforcé de l’aide aux victimes par l’institution judiciaire. A LIRE ICI
Volonté de recadrage institutionnel
La circulaire rappelle que la prise en charge des victimes doit être « un axe essentiel » piloté et suivi par les chefs de cour et de juridiction, avec des politiques de juridiction partagées avec les auxiliaires de justice, les enquêteurs, les services pénitentiaires, et les associations, dans un cadre coordonné et animé par l’autorité judiciaire. Elle impose l’organisation systématique de conseils de juridiction dédiés, la rédaction d’un état des lieux exhaustif de l’accueil et de l’aide apportés, et l’élaboration d’un document opérationnel support d’évaluation locale de l’amélioration de l’aide aux victimes. Cela traduit un cadrage fort de la politique d’aide, placée sous le contrôle étroit de la hiérarchie judiciaire.
Contrôle de l’action associative
La circulaire insiste sur le pilotage des associations d’aide aux victimes par les chefs de cour. Elle demande de s’assurer d’un « maillage territorial » adapté, de la qualité des actions, de la coordination locale (Justice, préfecture, barreau), ainsi que des modalités de financement et de conventionnement. Le rôle de contrôle est renforcé : les magistrats sont chargés d’assurer la connaissance et le suivi des actions associatives, ainsi que leur efficacité sur le terrain judiciaire. En parallèle, la systématisation du recours aux associations, encadrée par les parquets, confirme l’intention de maîtrise institutionnelle, avec des instructions précises sur l’orientation immédiate des victimes et la garantie d’un accompagnement professionnel agréé.
Exigence d’effectivité et reporting systématique
Des mesures d’organisation concrètes (conseils, protocoles, bilans publics, documents opérationnels, retours d’expérience sous contrôle judiciaire) sont imposées, avec l’objectif affiché de renforcer le suivi, la cohérence et la transparence des partenariats d’aide. La circulaire prévoit des reportings réguliers (rapports annuels, synthèses, pilotage via le juge délégué aux victimes), utilisés comme outils de contrôle et d’évaluation du dispositif.
Il s’agit d’un recentrage de l’aide aux victimes autour de l’autorité et du contrôle de l’institution judiciaire, visant à assurer cohérence, effectivité et visibilité accrues, tout en responsabilisant et en coordonnant de manière plus étroite l’ensemble des acteurs, notamment associatifs, intervenant auprès des victimes. On s’éloigne à l’évidence de la philosophie associative qui est fondée sur une réelle liberté et indépendance comme nous l’avons déjà souligné lors de la conférence des Présidents de France-Victimes A LIRE ICI.
III.- Victimologie
A.- Les mémoires du Président Périès
Jean-Louis Périès a publié des mémoires intitulées « Intime conviction : de l’affaire Dominici au procès du 13 novembre », parues aux éditions Flammarion le 22 octobre 2025.
Cet ouvrage de 346 pages retrace sa carrière de magistrat, depuis ses premières affaires marquantes (notamment l’affaire Dominici) jusqu’à la présidence du procès des attentats de novembre 2015 à Paris.
Il développe dans ce livre une réflexion sur la justice, ses doutes, ses convictions, et livre un témoignage personnel sur la gestion d’un procès hors norme.

B.- La justice restaurative
Il faut écouter et lire Antoine Garapon pour comprendre la justice restaurative et son plaidoyer éclairé pour une autre justice.
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-8h20/le-grand-entretien-du-dimanche-16-novembre-2025-8750170
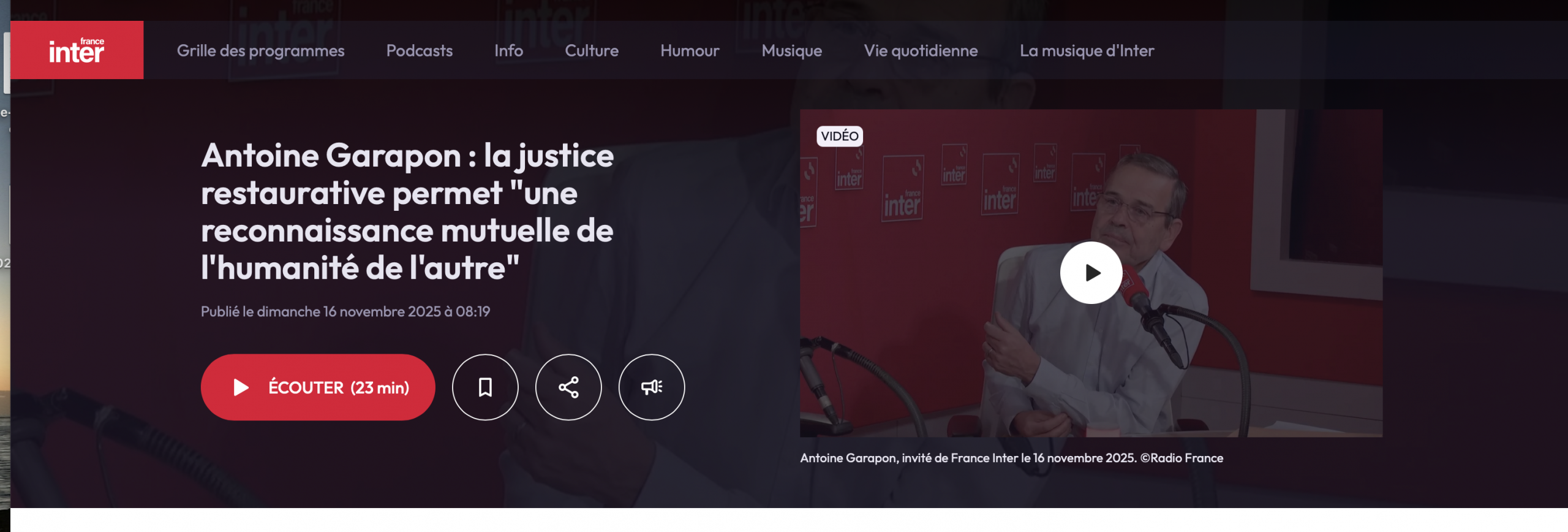
Pour une autre justice. La « voie restaurative » d’Antoine Garapon propose une réflexion profonde sur les limites du système pénal traditionnel et défend un nouveau modèle de justice centré sur la réparation et la reconstruction des victimes, dépassant la seule logique de la sanction.
Approche et thèse centrale
Antoine Garapon s’appuie sur son expérience de magistrat et d’expert en justice transitionnelle pour montrer que la justice pénale classique – qui se concentre sur le jugement et la punition du coupable – répond imparfaitement aux attentes profondes des victimes, notamment face à des crimes « injugeables » comme l’inceste, les abus sexuels ou les crimes de masse. La justice restaurative, selon lui, ne vise pas à effacer le passé mais à permettre une reconstruction personnelle et sociale, en mettant la victime au cœur de la démarche.
Principaux thèmes développés
- Incomplétude du droit pénal : Antoine Garapon explique pourquoi une simple application de la loi ne suffit pas à réparer le traumatisme et l’empêchement d’être des victimes. La prise en compte de leur expérience bouleverse l’idée classique de justice.
- Déjudiciarisation et dialogue : Il insiste sur la nécessité de sortir du schéma affrontement/jugement pour privilégier la rencontre, l’échange et la co-élaboration d’un sens face à l’irréparable. Ce travail vise à restaurer l’intimité blessée de la victime, au-delà de l’indemnisation chiffrée.
- Vision non vengeresse de la justice : La justice restaurative vise à offrir un espace où auteurs et victimes sont placés à égalité, permettant de dépasser la logique de la vengeance et d’aller vers la reconstruction, voire la « renaissance » de la victime.
- Réparation hors quantification : La réparation ne se limite pas à une compensation financière : il s’agit de reconstruire la continuité de la vie de la victime là où le crime l’a arrêtée, retrouvant ainsi sa dignité.
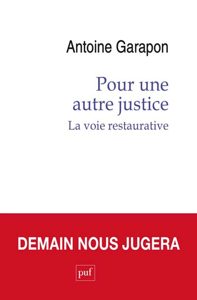
IV.- Violences routières
L’ après accident pour les victimes est marqué du sceaux de la complexité et la durée de ce processus qui est aussi scandé par les étapes médicales, insistant sur le rôle de la réadaptation, du soutien psychologique, familial et institutionnel pour permettre à la victime, ainsi qu’à ses proches, de se reconstruire malgré des séquelles souvent irréversibles.
Que la presse, ici régionale, s’en fasse l’écho est important et à sa manière un caractère préventif.
Après un accident grave de la circulation, les victimes et leurs proches font face à des difficultés multiples, tant physiques que psychologiques, sociales et économiques.
Difficultés physiques et fonctionnelles
- Les séquelles physiques liées aux blessures sont majeures : paralysies, amputations, perte de mobilité, troubles neurologiques, douleurs chroniques.
- La rééducation est souvent longue et difficile, visant à restaurer la motricité et l’autonomie pour des gestes quotidiens, parfois sans récupération complète
Atteinte psychologique et estime de soi
- Le choc psychique de l’accident marque profondément les victimes : perte de confiance, dévalorisation, sentiment d’inutilité ou de honte devant le handicap.
- L’impact sur l’identité (sentiment de ne plus être la même personne, angoisse, honte) et la confrontation au regard des autres sont fréquents.
- Des troubles anxieux ou dépressifs peuvent survenir, avec une perte de motivation pour la réinsertion.
Conséquences sociales et relationnelles
- Les proches vivent également une période de sidération et d’adaptation forcée: besoin de réorganiser la vie familiale, répartition des tâches, adaptation du logement.
- Les relations sociales et familiales sont mises à l’épreuve, avec parfois isolation, incompréhension ou sentiment de colère/fatigue chez les aidants.
Effets économiques et professionnels
- Les conséquences financières sont souvent importantes : perte brutale d’autonomie, diminution ou perte de revenus, frais médicaux et d’adaptation, difficulté à reprendre un emploi.
- Les démarches administratives deviennent un enjeu majeur: reconnaissance du handicap, indemnisation, gestion du retour à l’emploi ou d’une reconversion professionnelle.
Parcours de soin et réinsertion
- Le retour à une vie “normale” passe par la réadaptation, la rééducation et la réinsertion, mais reste incertain et semé d’obstacles physiques, sociaux et psychologiques.
- L’accompagnement pluridisciplinaire est essentiel pour gérer la complexité du parcours post-accident, mais il ne garantit pas l’effacement des difficultés.
Ces 3 articles ont un caractère pédagogique :



Surtout si on veut bien se rappeler qu’il y a une victime sur la route toutes les 3 minutes. A LIRE ICI STOP ! – Ligue contre la violence routiere.


