Claude LIENHARD
Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,
Professeur émérite de l’Université Haute-Alsace,
Directeur honoraire du CERDACC (UR 3992)
et
Catherine SZWARC
Avocate spécialisée en droit du dommage corporel
I – Droit du dommage corporel
1. L’indemnisation de la tierce personne pas de dérive low cost
L’arrêt du 15 mai 2025 (Cass. 2e civ., n° 23-13.005, A LIRE ICI ) rappelle que l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne ne peut être réduite lorsque l’aide est assurée par un membre de la famille : la Cour de cassation casse une décision d’appel qui avait diminué l’indemnisation au motif que la victime avait reçu l’aide de son épouse pour les tâches quotidiennes.
C’est le rappel d’une jurisprudence constante.
La jurisprudence de la Cour de cassation est ferme au regard du principe de réparation intégrale : le droit à indemnisation pour l’assistance par une tierce personne repose sur le besoin d’aide lui-même, peu importe que cette aide soit fournie par un professionnel ou un membre de la famille. Ce principe de « réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime » interdit toute réduction de l’indemnité lorsque l’aide est familiale, et il n’est pas exigé de justificatifs de dépenses effectives. Par contre des devis du coût de telles prestations in concreto sont utiles éviter la fixation d’un taux horaire sous-évalué.
2. L’importance encore du point de départ du délai de prescription et de la date de consolidation du dommage
Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que, pour un préjudice lié à contamination comme en cas d’une infection à l’hépatite C, la prescription pour solliciter l’indemnisation ne cours pas tant que le dommage n’est pas consolidé (A LIRE ICI).
Aussi longtemps que le dommage de la victime n’est pas consolidé, la prescription est suspendue, ce qui protège les droits des victimes atteintes de pathologies évolutives ou décontamination tardivement révélée.
II – Droit des victimes
1. L’avènement législatif de l’homicide routier
La loi du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier marque un profond changement juridique dans la lutte contre les violences routières. Elle s’inscrit dans une ambition nationale et européenne pour la sécurité routière et vise un intérêt public (A LIRE ICI). Ce texte n’est ni opportuniste ni compassionnel : il s’agit d’une loi qui vise le bien commun, fruit d’une prise de conscience des parlementaires face à l’ampleur du fléau routier. La mort routière est qualifiée de spécifique : elle affecte fortement les proches et a un coût économique et social important. L’analyse montre que ces morts sont rarement de simples accidents, mais la conséquence de comportements inacceptables socialement. La création d’un nouveau délit pour les conducteurs ayant causé la mort après une conduite délibérément risquée était donc indispensable.
La loi est d’application immédiate. Elle est accompagnée d’une circulaire de bonne facture pédagogique à laquelle nous renvoyons pour l’essentiel (A LIRE ICI ).
Nous reviendrons plus amplement sur cette loi et ces premières applications dans les prochains JAC.
2.Les sociétés de recours : un danger pour les victimes
Il était temps que le Cour de cassation intervienne.
L’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2025 confirme que toute assistance juridique en indemnisation est réservée aux professionnels réglementés (avocats, experts judiciaires, associations agréées) A LIRE ICI .
Les sociétés de recours et certains intermédiaires non-avocats prétendent accompagner les victimes dans leurs démarches d’indemnisation, mais exercent en réalité une activité juridique déguisée, sans contrôle légal, ni règles déontologiques
Leur intervention prive souvent les victimes de protections essentielles :
-transactions défavorables,
-opacité des liens avec assureurs,
-limitation du libre choix de l’avocat.
Depuis longtemps, l’Anadavi dénonçait cette situation de braconnage (A LIRE ICI ) .
L’arrêt est clair, il ne fait plus de doute qu’une intervention principale, habituelle et rémunérée auprès des victimes constitue un exercice illicite du droit, qualifié de trouble manifestement illicite, justifiant l’arrêt sous astreinte judiciaire de cette activité, l’annulation des actes concernés et la mise en cause de la responsabilité des structures impliquées (compris les assureurs partenaires).
III. Victimologie
1.Les accidents transforment les destins et les vies, une riche rentrée littéraire
Accidents et renaissance : Cédric Sapin-Defour
L’article sur Cédric Sapin-Defour retrace le bouleversement provoqué par l’accident de parapente de son épouse, Mathilde. Ancien grand sportif, il raconte dans « Là où les étoiles tombent » comment ce drame a non seulement fragilisé son équilibre puis celui de son couple, mais a permis une forme de renaissance, de redéfinition des priorités et de l’amour. Le récit met en avant la reconstruction après le choc, la rééducation de Mathilde et la leçon profonde d’amour et d’entraide qui en découle. C’est aussi une réflexion sur l’aide aux autres, la gestion du quotidien après un accident, et la capacité à retrouver l’équilibre quand tout s’effondre.

Accidents et familles bouleversées : David Foenkinos
Dans « Tout le monde aime Clara », David Foenkinos évoque une famille dont la vie bascule lorsque Clara, 17 ans, est plongée dans le coma après un accident de voiture. Le roman explore le traumatisme, la résilience puis la capacité insoupçonnée à renaître grâce à l’expérience de la douleur. Foenkinos parle aussi de la force des livres et de l’écriture comme consolation et outil de reconstruction après l’épreuve. L’accident, loin d’être une simple parenthèse tragique, devient le catalyseur d’une nouvelle façon d’aimer, de vivre et d’accueillir la délicatesse et l’espoir, même dans le chaos.
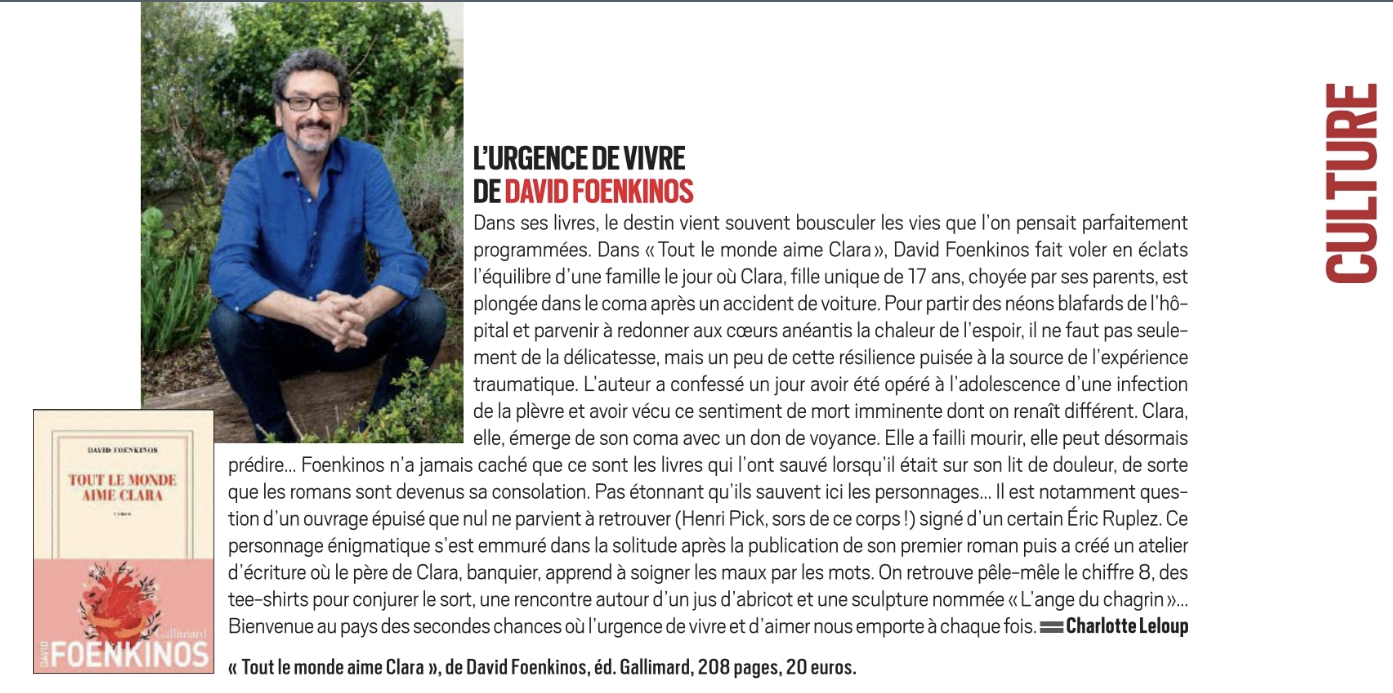
Tragédie collective : David Deneufgermain
Enfin, David Deneufgermain, psychiatre et écrivain, aborde dans « L’Adieu au visage » la gestion des morts du Covid à l’hôpital Nord de Marseille. Ce témoignage romancé met en scène la sidération des soignants face à une vague de traumatismes et de décès, la nécessité d’adaptation perpétuelle, et la cruauté des protocoles funéraires imposés par la crise sanitaire. Le roman montre comment les expériences traumatiques collectives, comme la pandémie, transforment en profondeur les vies des individus – soignants, familles, survivants – et obligent chacun à inventer de nouvelles formes d’humanité et de résilience face à la brutalité du destin.

2.L’après catastrophe des effets différés et parfois indésirables
AZF
La catastrophe de l’explosion de l’usine AZF en 2001 reste un événement profondément douloureux dans la mémoire collective, malgré la dépollution et la reconversion progressive du site.
Près de 24 ans après le drame, la trace matérielle du cratère créée par l’explosion, où 31 personnes ont trouvé la mort et des milliers d’autres ont été blessées, demeure préservée comme un « cratère de catastrophe ». Ce lieu, longtemps resté à l’écart et protégé par des scellés, incarne la souffrance et le choc qu’a provoqués la tragédie auprès des habitants de Toulouse et au-delà.
Le site est désormais intégré dans un parcours de mémoire jouxtant le Mémorial de la catastrophe, rappelant ainsi en permanence la gravité de l’événement. L’installation d’objets emblématiques de l’usine, comme l’énorme tube de 95 tonnes, contribue à matérialiser ce qui reste du passé industriel tout en marquant la blessure mémorielle du territoire. La présence de panneaux explicatifs et la transformation du cratère en un espace protégé entretiennent le souvenir des victimes et du traumatisme collectif. Si la dépollution ouvre la voie à de nouveaux usages du site tournés vers la santé, le sport et la formation, le souvenir de la catastrophe demeure central. La préservation du cratère et la conservation de pièces majeures de l’usine témoignent d’un choix de la collectivité d’assumer cette mémoire douloureuse tout en regardant vers l’avenir.

Furiani
La persistance du souvenir douloureux lié au drame de Furiani est toujours là et resurgit à travers la controverse autour de l’hommage à Jean-François Filippi, ancien maire de Lucciana et président du SC Bastia lors de la catastrophe de 1992.[
L’apposition d’une plaque commémorative à l’école de Crucetta a ravivé le débat sur la place de la mémoire collective, notamment pour les familles des victimes qui perçoivent cette initiative comme une forme d’oubli du traumatisme vécu. Le collectif du 5-Mai, au cœur de la mémoire du drame, a exprimé publiquement sa profonde déception, soulignant que l’hommage ne tenait pas compte du ressenti des personnes directement affectées par la tragédie.
La polémique révèle à quel point la mémoire du drame de Furiani continue d’être vive et sensible dans la société corse. L’adoption du nom de Jean-François Filippi dans l’espace public reste une source de malaise, signe que les souvenirs restent douloureux pour de nombreux acteurs locaux, et que la réconciliation mémorielle autour de ce drame historique demeure inachevée.



