Claude LIENHARD
Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,
Professeur émérite de l’Université Haute-Alsace,
Directeur honoraire du CERDACC (UR 3992)
et
Catherine SZWARC
Avocate spécialisée en droit du dommage corporel
I – Droit du dommage corporel
1. Femmes excisées
Les femmes excisées peuvent être réparées physiquement et psychologiquement. Voilà encore une initiative qui répond à l’impératif de réparation.
Sarah Abramowicz, chirurgienne obstétricienne : « Réparer l’excision, ce n’est pas seulement réparer un clitoris ou une vulve, c’est aussi prendre soin de la souffrance psychique »
A la tête de l’unité de prise en charge des victimes de mutilations sexuelles féminines de l’hôpital André-Grégoire, à Montreuil, Sarah Abramowicz veut faire reconnaître l’excision comme une violence sexuelle à part entière.

Ainsi la France renforce sa lutte contre l’excision par des parcours de soins innovants, des plans institutionnels ambitieux, l’amélioration de l’accès à la chirurgie réparatrice et une prévention accrue, particulièrement en Île-de-France, région la plus touchée par cette pratique. Ces initiatives visent à offrir aux femmes excisées un véritable chemin de réparation et de résilience.
2. L’infirmier « augmenté » désormais en pole position probatoire
Les sénateurs ont adopté définitivement la loi sur la profession d’infirmier, symbole d’une reconnaissance longtemps attendue par ces soignants très engagés.
Le nouveau statut des infirmiers, notamment la création de l’infirmier référent, marque une reconnaissance accrue de leur rôle central dans le parcours de soins, avec des missions élargies et une coordination renforcée avec les autres professionnels de santé.
Parallèlement, une vaste réforme de la formation et de la définition des compétences est en cours, visant à adapter la profession aux besoins actuels du système de santé et à offrir davantage d’autonomie et de responsabilités aux infirmiers.
Le Conseil national de l’Ordre des infirmiers se réjouit de l’adoption définitive, ce jour au Sénat, de la proposition de loi relative à la profession infirmière, quelques semaines après son vote unanime à l’Assemblée nationale. Ce texte, attendu depuis de nombreuses années par la profession, constitue une avancée législative majeure et marque une étape historique dans la reconnaissance des compétences, des missions et de l’autonomie des infirmières et infirmiers en France.
« Cette loi marque un tournant décisif pour notre profession. Elle affirme avec force la compétence, la responsabilité et la capacité d’agir des infirmières et des infirmiers, au plus près des besoins de la population. Nous serons au rendez-vous de sa mise en œuvre et particulièrement attentif à ce que les décrets d’application soient à la hauteur de son ambition » déclare Sylvaine Mazière-Tauran, présidente du Conseil national de l’Ordre des infirmiers. A LIRE ICI
Comme le titre avec pertinence le Journal La Croix « L’infirmier libéral est dans la vraie vie des gens ».

Avec la transformation du métier d’infirmier, attendue de longue date, ces professionnels de santé vont se voir attribuer notamment un pouvoir de prescription de certains médicaments. Ils vont également être plus présents et autrement présents auprès des patients, mais donc aussi près des victimes. Ce sont des professionnels qui vont pouvoir délivrer, le cas échéant, et à la demande des victimes, des certificats et peut-être même des attestations utiles à l’instruction des dossiers de dommage corporel.
La victime, ayant la charge de la preuve, sera amenée à les solliciter et ces documents probatoires devront bien entendu être pris en compte et auront une valeur médico-légale au regard du statut renforcé des infirmiers.

II – Droit des victimes
1. La place de l’avocat à l’expertise
La présence de l’avocat lors de l’examen clinique au cours d’une opération d’expertise civile est une question grave, essentielle, notamment pour les expertises psychiatriques. La deuxième chambre civile, dans un arrêt rendu le 30 avril, estime que l’examen clinique de la victime peut se faire en l’absence de ses avocats, et ce, contrairement à la volonté de la victime.
C’est un arrêt regrettable, critiquable, ou qui, pour le moins, témoigne d’une méconnaissance de la pratique et d’une déconnexion de la part de la haute juridiction régulatrice.
La situation qui découle de cet arrêt ne peut être laissée en l’état. Il est important que la question soit soumise à la Cour européenne des droits de l’homme, garante de l’effectivité du droit des victimes. Elle le sera vraisemblablement.
Le commentaire critique particulièrement pertinent du Professeur Bruno Py incite à aller vers un tel arbitrage (A LIRE ICI).
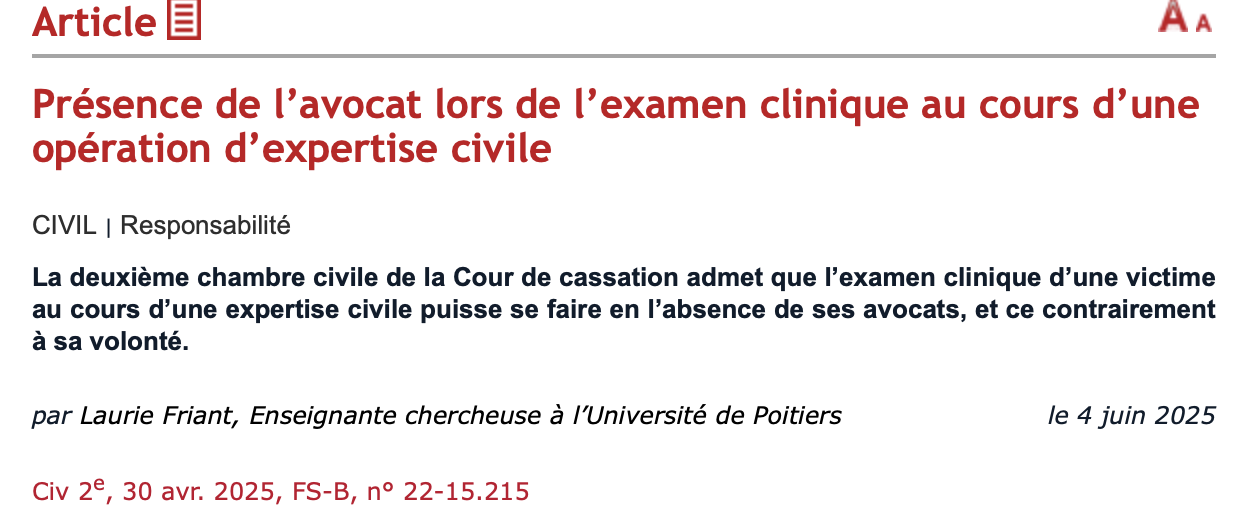
2. Féminicide les enfants, victimes oubliées ?
Victimologie, le chemin de croix des enfants de victimes de féminicides.
Ce documentaire choc, diffusé sur Canal+, décrypte les conséquences de ce crime pour les fils et les filles des victimes. Bouleversant !


En effet, les enfants de victimes de féminicide sont des co-victimes particulièrement vulnérables, souvent orphelins d’un ou des deux parents, et parfois témoins directs des violences ayant conduit au meurtre de leur mère.
En France, chaque année, plusieurs dizaines d’enfants perdent leur mère à cause d’un féminicide. Par exemple, en 2023, sur 146 féminicides recensés, environ 80 enfants ont perdu un parent.
Ces enfants subissent un traumatisme psychique intense, combinant le deuil de leur mère et la violence du père, qui est souvent l’auteur du meurtre.
III. Victimologie
1.Les ravages sans fin de la violence routière
Du côté des accidents, on retrouve les conséquences dramatiques et quotidiennes de la violence routière.
Ici, le combat de la mère de Nathael, tué à vingt ans.
« Je voudrais que cela ne soit jamais arrivé. » (A LIRE ICI)
Là une autre mère témoigne.
L’année dernière, à cette époque, on était quatre.
Le 5 juin 2024, une automobiliste de quatre-vingt-trois ans fauchait un groupe d’enfants à vélo, avenue Coligny, à La Rochelle. Une petite fille, Margaux, dix ans, était tuée.

À Nice, dix-neuf morts, quarante-neuf blessés graves en cinq ans sur la promenade des Anglais, en plein centre de l’agglomération. Les violences routières sont en forte progression. A LIRE ICI
À Antibes, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture et a foncé sur une maman et ses deux filles qui marchaient sur le trottoir.
La mère a succombé à ses blessures. A LIRE ICI
On relèvera encore le voyeurisme accidentogène. Lors d’une coupure de l’A7 par un poids lourd, une centaine d’automobilistes ont été verbalisés pour avoir filmé l’accident au risque de créer un suraccident (A LIRE ICI).
2.L’ avénement espéré de l’homicide routier
La création d’une infraction spécifique d’« homicide routier » dans le code pénal français a franchi une étape décisive en juin 2025.
Après un parcours parlementaire marqué par des interruptions, notamment la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024, la proposition de loi a été adoptée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le 3 juin 2025, à une très large majorité (194 voix pour, 6 contre). A LIRE ICI
Le texte doit désormais être examiné en deuxième lecture au Sénat, avec une discussion publique prévue le 1er juillet 2025. Les associations de victimes et le gouvernement espèrent une adoption définitive d’ici l’été, afin que la loi puisse entrer rapidement en vigueur.
Ce texte devrait permettre une nouvelle technique et culturelle de la réponse judiciaire à la violence routière la plus grave.


